
- Fiches d’introduction au droit
- Fiches de droit constitutionnel
- Fiches d’introduction historique au droit
- Fiches de droit des personnes
- Fiches de droit de la famille
- Fiches de droit des contrats
- Fiches de droit administratif
- Fiches de droit pénal
- Fiches de responsabilité civile
- Fiches de droit de l’Union européenne
- Fiches de régime général des obligations
- Fiches de procédure civile
- Fiches de droit des biens
- Fiches de droit commercial
- Fiches de droit commun des sociétés
- Fiches de droit des contrats spéciaux
- Fiches de droit international public
- Méthodologie
- Introduction au droit
- Droit constitutionnel
- Introduction historique au droit
- Droit des personnes
- Droit de la famille
- Droit des contrats
- Droit administratif
- Droit pénal
- Responsabilité civile
- Droit de l’Union européenne
- Régime général des obligations
- Procédure civile
- Droit des biens
- Droit commercial
- Droit des sociétés
- Contrats spéciaux
- Droit international public

Exemple de dissertation en droit administratif
Par Maxime Bizeau, Avocat de formation, diplômé de l'école d'avocats du Barreau de Paris
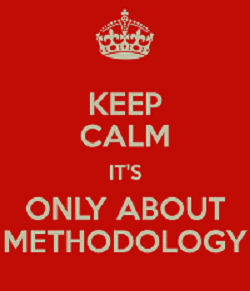
[Cliquez ici pour télécharger 20 fiches de révisions pour réviser efficacement le droit administratif !]
Vous trouverez ci-dessous un exemple de dissertation en droit administratif. Cette dissertation a été réalisée par une étudiante en L2 Droit à l’Université de Nanterre. Elle a obtenu la note de 16/20.
Bonne lecture !
Sujet de la dissertation : Que reste-t-il de la théorie de l’écran législatif ?
François Mitterrand, ancien Président de la République énonce en 1988, à la veille de l’ouverture de la première cohabitation de la Vème République, la citation restée célèbre « La Constitution, rien que la Constitution, toute la Constitution ».
En effet, à cette occasion, il rappelait l’idée selon laquelle la Constitution est la norme suprême dans l’ordre juridique français et que toutes les normes inférieures doivent théoriquement la respecter. Hans Kelsen, au début du XXème siècle, dans son ouvrage Théorie pure du droit , a d’ailleurs défini la notion de hiérarchie des normes : cette fameuse pyramide fondée sur le principe de légalité selon laquelle toute norme doit être conforme à la norme supérieure pour pouvoir être appliquée, la Constitution se trouvant à son sommet.
Cette primauté pouvait néanmoins être discutée dès lors que, selon le principe de séparation des pouvoirs , le juge administratif ne pouvait pas contrôler la constitutionnalité d’une loi comme en témoigne l’arrêt Arrighi (1936). En effet, à cette occasion, le juge se déclarait incompétent pour apprécier la constitutionnalité d’une loi. Or c’est de cette incapacité que découle la théorie de la loi écran.
On parle en effet de théorie de « loi écran » ou « d’écran législatif » lorsque la loi, contenant des dispositions de fond, est précisée ou sert de fondement à des actes administratifs. Puisque les juges ordinaires ne sont pas juges de la constitutionnalité de la loi, ils ne peuvent pas non plus être juges de la constitutionnalité des dispositions qui la prolongent. Alors, sanctionner ces actes administratifs, serait déjà être juge constitutionnel. Cette théorie n’est pas sans poser de problème : en empêchant de sanctionner la violation par l’administration de la Constitution, on retire à cette dernière son caractère de norme suprême, ce qui reste paradoxal au regard de la hiérarchie des normes.
D’autres États ne rencontrent cependant pas ce problème. Ainsi, par exemple, le système américain autorise de manière historique le juge à procéder à un contrôle de constitutionnalité des lois par voie d’exception : les lois ne peuvent donc pas faire écran entre la Constitution et les actes administratifs.
Or, après plusieurs échecs infructueux, a été introduit, avec la révision constitutionnelle de 2008, un mécanisme de contrôle de constitutionnalité de la loi par voie d’exception (c’est-à-dire à l’occasion d’un litige). En effet, le juge administratif comme judiciaire peut être saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) qui sera portée devant le Conseil constitutionnel (article 61-1 de la Constitution). Cela devrait entraîner une disparition de la loi écran. D’autant que la QPC fait suite à la reconnaissance progressive par le juge administratif du pouvoir de contrôler la compatibilité de la loi avec les normes internationales dont certaines garantissent des droits similaires à ceux que garantit la Constitution. L’arsenal juridique pour lutter contre la théorie de l’écran législatif s’élargit encore avec la théorie de l’écran législatif transparent.
Par conséquent, il est possible de se demander si la théorie de la loi écran a pu survivre à l’avènement des moyens de contrôle de la loi par voie d’exception dans le droit français.
Dès lors qu’il était impossible, selon la théorie de la loi-écran, au juge administratif de contrôler la loi promulguée (I), l’évolution du système et l’introduction de la QPC a-t-il vraiment remis en cause l’avenir de la loi-écran (II) ?
I/ La théorie de la loi-écran comme conséquence de l’impossibilité par le juge administratif de contrôler la loi promulguée
La théorie de la loi-écran, est le principe selon lequel le juge administratif se refuse à déclarer illégal un acte administratif conforme à une loi mais contraire à un acte de valeur juridique supérieure. C’est pourquoi la loi écran respecte les principes fondamentaux du droit public (A). Cependant, le contrôle de conventionnalité reste un moyen de limiter le champ d’application de cette loi-écran (B).
A/ La théorie de la loi écran comme résultat des principes fondamentaux du droit public
Aux vues de la hiérarchie des normes, la Constitution s’impose à toutes les autorités politiques et juridictionnelles. En conséquence, le législateur, prenant part au pouvoir législatif se doit de respecter la Constitution auquel cas sa loi sera désignée inconstitutionnelle par le Conseil constitutionnel. De même pour le pouvoir exécutif, qui lui aussi se doit de respecter la Constitution au risque que ses actes administratifs soient considérés comme contraires à cette même Constitution par le juge administratif.
Cependant, cela comporte des complications. En effet, la théorie de la loi écran implique que lorsque le législateur prend une loi, il est possible que certains actes administratifs soient pris sur son fondement. Ainsi en est-il par exemple des décrets d’application ou de décisions individuelles prises par une autorité exécutive. Ici, il est possible que l’acte administratif ne fasse que prolonger, se borne à réitérer les dispositions de la loi. Alors, si le juge administratif contrôle la constitutionnalité de l’acte administratif, il contrôlera en même temps la constitutionnalité de la loi.
Aussi, le Conseil d’État a refusé le 6 novembre 1936 dans une décision Arrighi , d’être le juge de la constitutionnalité de la loi. D’ailleurs, en 1958, ce n’est pas au juge qu’a été confié le rôle de la constitutionnalité de la loi, mais au Conseil constitutionnel. Afin d’expliquer cette idée, deux arguments doivent être mis en évidence : la séparation des pouvoirs et la légitimité des législateurs.
La séparation des pouvoirs, théorisée dès Aristote, sera largement développée par Locke et par Montesquieu. Cette théorie est un principe fondamental qui sépare les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire en trois autorités bien distinctes qui peuvent néanmoins entretenir des rapports selon qu’elle est dite stricte ou souple. Mais, en l’espèce, le juge administratif qui jugerait d’un acte administratif couvert par une loi jugerait aussi de la loi, ce qu’il ne peut pas faire puisqu’il fait partie de l’autorité judiciaire. Il empiéterait sur le pouvoir législatif et méconnaîtrait la séparation des pouvoirs. C’est pourtant ce qu’il ferait en jugeant de la constitutionnalité des actes administratifs qui prolongent une loi. La seconde idée est un motif plus politique. En effet, le législateur est le représentant du souverain. Or le souverain, parce qu’il est le pouvoir suprême, ne peut pas voir ses décisions contrôlées. L’inverse reviendrait à reconnaître un pouvoir supérieur à celui du souverain logiquement, le juge ne peut contredire le souverain et donc contrôler une loi qui est issue de sa volonté ou de celle de ses représentants.
Cette situation n’est pas sans poser de problèmes, en effet, à cause de la loi écran, naissent des actes administratifs contraires à la Constitution qu’on ne peut pas abroger. Ainsi, il est obligatoire d’appliquer certains actes administratifs qui peuvent être contraires à la Constitution.
B/ Le contrôle de conventionnalité ; moyen de réduire le champ d’application de la loi écran
Dans un premier temps, il est important de rappeler que le juge administratif a essayé d’empêcher ce mécanisme de loi écran. On ne peut sanctionner la loi à cause de la séparation des pouvoirs. Ainsi, le juge administratif cherche des moyens alternatifs. Bertrand SEILLER, professeur à l’Université Paris II, remarque dans son ouvrage Droit Administratif , que le premier élément que le juge peut voir pour contrer la loi écran, c’est d’interpréter la loi. Le Conseil d’état l’a d’ailleurs déjà fait, dans une décision Dame Lamotte du 17 février 1950 . En effet, dans le cadre de cette décision le Conseil d’Etat estime qu’une disposition législative interdisant tout recours contre une concession n’excluait pas le recours pour excès de pouvoir . Appliqué à la loi écran, ce travail d’interprétation permet de surmonter le problème de cette loi écran puisqu’en interprétant la loi, on la rend conforme à la Constitution. En effet, cela peut avoir deux conséquences :
- Soit l’acte administratif prolonge une loi désormais conforme à la Constitution : il est donc lui-même conforme à la Constitution.
- Soit l’acte administratif prolonge mal la loi : il est donc contraire à la loi et donc il est possible de le censurer.
Le développement du contrôle de conventionnalité, c’est-à-dire du contrôle visant à établir la conformité ou la non-conformité d’une norme de droit interne à une convention internationale, est un autre moyen. Conformément à l’article 55 de la Constitution de 1958, le contrôle de conventionnalité vise surtout à assurer la supériorité des engagements internationaux et européens ratifiés par la France sur les lois et les règlements internes. Dans la décision IVG du 15 janvier 1975, le Conseil constitutionnel invite le juge administratif et le juge judiciaire à contrôler la compatibilité des lois avec une convention internationale. La Cour de cassation va accepter directement à travers une décision du 24 mai 1975 Jacques Vabre . Le Conseil d’Etat, lui, mettra plus de temps, mais il finira lui aussi par accepter en 1989 dans une décision Nicolo . Par le biais de cette décision, le Conseil d’Etat accepte de réaliser le contrôle de conventionnalité.
Désormais, le juge administratif, se déclare compétent pour écarter l’application d’une loi dans un litige, dès lors que celle-ci ne serait pas compatible avec un traité auquel la France serait partie. Alors, si un acte administratif est pris en application d’une loi, et que cet acte administratif est contraire à la Constitution, le juge administratif dispose désormais d’un moyen de ne pas en faire application. En effet, à défaut de contrôler la conformité de la loi à la Constitution, il pourra en étudier la compatibilité avec les traités. Si la loi n’est pas compatible avec les traités le juge administratif doit l’écarter, mais en conséquence il écarte aussi les actes administratifs pris sur son fondement.
Finalement, le juge administratif ne peut pas juger la loi, mais il peut écarter l’acte administratif pris sur le fondement de cette loi et donc en écarter son application. La loi peut désormais être sanctionnée à défaut d’être abrogée, mais c’est surtout avec la question prioritaire de constitutionnalité que la théorie de la loi écran se réduit très fortement.
II/ La QPC ; vers une disparation de la loi écran
La question prioritaire de constitutionnalité, système récent, permet une possible future disparation de la loi-écran ou alors une forte réduction de celle-ci (A). Cependant, la théorie de l’écran législatif existe toujours et persiste malgré la menace (B).
A/ Le contrôle QPC ; une très forte réduction de la théorie de la loi écran
La question prioritaire de constitutionnalité (QPC) permet à tout justiciable de contester la constitutionnalité d’une disposition législative à l’occasion d’un procès devant une juridiction administrative ou judiciaire, lorsqu’il estime qu’un texte porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. C’est un mécanisme utile car lorsqu’il s’agit de la loi écran, le contrôle de conventionnalité détient certaines limites.
Tout d’abord, il est vrai que les conventions internationales représentent un catalogue de droits qui ressemblent à ceux qui sont protégés par la Constitution. Mais tous les droits ne sont pas forcément présents dans les conventions internationales et dans la Constitution. Ainsi, par exemple, le principe de fraternité auquel le Conseil constitutionnel a donné valeur constitutionnelle, dans une décision QPC du 6 juillet 2018, ne se retrouve pas dans la CEDH. En conséquence, il est tout à fait possible qu’une loi, soit contraire à la Constitution mais conforme aux conventions internationales. Alors, le juge administratif ne pourra pas contrôler la constitutionnalité d’un acte administratif pris sur le fondement de cette loi et ne pourra pas non plus empêcher l’application de cet acte administratif par le biais du contrôle de conventionnalité.
De plus, le contrôle de conventionnalité n’exige qu’une compatibilité entre la loi et le traité là où le contrôle de constitutionnalité exige la conformité de la loi avec la Constitution. Ainsi, le contrôle de conventionnalité est plus léger que le contrôle de constitutionnalité. Alors, quand bien même un droit serait protégé par la Constitution et par les traités, il est possible qu’une loi soit considérée comme contraire à la Constitution et comme compatible avec un traité. Ici, le juge administratif est impuissant contre la théorie de la loi écran.
D’autre part, le contrôle de conventionnalité a des effets inter partes (entre partie). C’est-à-dire qu’il s’applique entre les parties au litige. C’est-à-dire qu’une loi déclarée contraire à une convention internationale ne disparaît pas de l’ordre juridique, mais se borne à ne pas être appliquée dans le litige en question (où a été soulevé le contrôle de conventionnalité). Le problème est que les juridictions administratives sont nombreuses, et que la jurisprudence est fixée par le Conseil d’Etat. En somme, tant que le Conseil d’Etat n’a pas déclaré une disposition législative comme étant compatible avec une convention internationale, toutes les juridictions administratives peuvent décider en conscience de la compatibilité ou non de cette disposition législative avec une convention internationale. La loi pourra donc faire écran devant une juridiction A mais pas devant une juridiction B.
En conséquence, rien n’indique que le contrôle de conventionnalité soit un moyen efficace de combattre en tous lieux la théorie de la loi écran. La QPC ne souffre pas de ces limites. Ainsi, dans l’hypothèse où le juge administratif, se voit saisi d’un litige dans lequel un acte administratif possiblement contraire à la Constitution est couvert par une loi, il suffira qu’une QPC soit soulevée pour que la théorie de la loi écran cesse. En effet, le juge constitutionnel saisi pour trancher de la constitutionnalité ou non d’une loi, rendra une décision d’où le Conseil d’Etat n’aura qu’à tirer les conséquences suivantes :
- Soit la loi est conforme à la Constitution, auquel cas l’acte administratif pris sur son fondement l’est aussi.
- Soit la loi n’est pas conforme à la Constitution : dans ce cas, le juge constitutionnel l’abroge et cette loi ne peut donc plus couvrir l’acte administratif (dont on peut facilement obtenir l’abrogation par le recours pour excès de pouvoir).
Néanmoins, il est possible que le développement de la QPC ne suffise pas à faire disparaître la théorie de la loi écran. C’est ce dont témoigne notamment la jurisprudence du Conseil d’Etat. En effet, la Haute juridiction administrative, théorisera la notion d’écran transparent (l’écran est dit transparent si la loi ne contient pas de véritable règle de fond (Arrêt Quintin, 1991)) et il en donnera une définition extensive dans une décision Air Algérie en date de 2012. Or, la QPC est entrée en vigueur le 1 er mars 2010. Si la QPC suffisait à combattre définitivement la théorie de la loi écran, alors comment expliquer que le Conseil d’Etat élabore encore des moyens pour mettre un terme à cette théorie ?
B/ Une légère persistance de la théorie de l’écran législatif malgré le contrôle QPC
Un problème fondamental est posé ici. En effet, il faut saisir le Conseil constitutionnel pour qu’il y’ait une QPC. Autrement dit, le Conseil constitutionnel ne se saisit pas automatiquement : il faut que la QPC soit provoquée. Or, si jamais la QPC n’est pas soulevée, le Conseil constitutionnel ne se prononcera pas sur la loi déjà promulguée. Ainsi, on a une loi qui continuera de faire « écran ».
Suite à cela, toutes les QPC soulevées ne vont pas jusqu’au Conseil constitutionnel. Il y a un rôle de filtre qui est réalisé notamment par le Conseil d’Etat. Celui-ci va se demander si la question est nouvelle, réelle et sérieuse. Si jamais il estime que ce n’est pas le cas, il ne transmet pas la QPC au juge constitutionnel. Ainsi, le Conseil constitutionnel ne peut pas abroger la loi et la loi continue de faire écran. Or, il est déjà arrivé que le Conseil d’Etat s’autorise à réaliser un contrôle très poussé de la possible inconstitutionnalité de la loi, dans le cadre de son rôle de « filtre ». Ainsi en est-il par exemple, dans une décision CUAZ du 27 octobre 2010, dans laquelle le Conseil d’État a considéré qu’une loi parce qu’elle ne portait pas excessivement atteinte à la Constitution, ne méritait pas d’être transmise au Conseil constitutionnel. Ce qui signifie donc, que le contrôle de constitutionnalité par voie QPC repose sur la bonne volonté et sur l’analyse du Conseil d’Etat. En somme, il est possible qu’une loi potentiellement contraire à la Constitution ne soit pas transmise au Conseil constitutionnel. De fait, le Conseil constitutionnel ne pourra pas la censurer. Ainsi, la loi continuera donc à couvrir l’acte administratif.
En définitive, il semblerait que la théorie de la loi écran puisse persister dans une situation plus théorique qu’autre chose. En effet, l’acte administratif qui serait couvert par une loi compatible avec les traités auxquels la France participe, mais qui serait contraire à la Constitution ne peut pas être censuré par le juge constitutionnel soit saisi restera protégé par la théorie de la loi écran.
Ainsi cela signifie que la loi écran se restreint de plus en plus, sans pour autant totalement disparaître.
Bibliographie :
- Hans Kelsen (1881-1973), Théorie Pure du droit, 1962
- CE, Sect. 6 nov. 1936, Arrighi , Rec . 966
- Article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article. »
- Bertrand Seiller, Droit Administratif. II. L’action administratif. 7 ème édition
- CE, Ass. 17 fév. 1950, Ministre de l’Agriculture c. Dame Lamotte , GAJA n° 60
- Constitution du 4 octobre 1958, Article 55 : « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie. »
- CC, décision n° 75-54 DC du 15 janv. 1975, Interruption volontaire de grossesse , Rec . 19
- Cass., ch. mixte, 24 mai 1975, Sté des cafés Jacques Vabre , D . 1975, p. 497
- CE, Ass. 20 oct. 1989, Nicolo, GAJA n° 90
- CC, 6 juillet 2018, n°2018-717/718 QPC
- CE, 17 mai 1991, Quintin, RDP 1991.1429
- CE, 6 déc. 2012, Société Air-Algérie , AJDA 2012, p. 2380, chron. Domino et Bretonneau, n°347870
- CE, 3 ème et 8 ème sous-sections réunies, 27 octobre 2010, 342925
C’est tout pour cet exemple de dissertation en droit administratif. J’espère que cela vous aidera pour rédiger vos dissertations en droit administratif.
Articles similaires :
Arrêt de cassation : définition, structure et exemples
Arrêt de rejet : définition, structure et exemples
Fiche d’arrêt : méthodologie et exemple
Exemple de cas pratique en droit administratif

Je m’appelle Maxime Bizeau, et je suis avocat de formation, diplômé de l’école d’avocats du Barreau de Paris .
Après mon bac, je me suis lancé dans l’aventure de la licence de droit.
Mais très vite, je me suis senti submergé par la charge de travail . Des centaines et des centaines de pages à apprendre, sans savoir sur quoi se focaliser, sans savoir ce qui était réellement important et ce qui ne l'était pas.
Mes résultats étaient irréguliers , et pas à la hauteur de mes espérances.
J’ai donc décidé de changer ma méthode de travail. Plutôt que d'essayer de tout retenir, j'ai commencé à ficher mes cours régulièrement, et à relire ensuite mes fiches avant les examens.
Rapidement, mes résultats se sont considérablement améliorés .
J’ai finalement validé ma licence avec mention ( 13,32 de moyenne ) et mon master 1 en droit des affaires avec 15 de moyenne .
Ces bons résultats m’ont ouvert les portes du prestigieux Master 2 Droit financier de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne , et des plus grands cabinets d’avocats d’affaires internationaux .
J’ai ainsi pu travailler dans des cabinets anglo-saxons très réputés à Paris, avec des gens brillants, sur des dossiers passionnants, et dans des conditions optimales.
A travers ce site, je souhaite aider un maximum d’étudiants en droit à atteindre leurs objectifs.
Bonjour maxime , Merci encore pour vos articles très intéressants et très très pratiques, Je suis intéressée par vos fiches de droit administratif L2 , est ce cela est disponible ? Je tiens à confirmer et à témoigner que vos fiches m’ont été d’une aide incroyable, étant en reprise d’étude avec des enfants en bas âge, utilisé vos fiches était un moyen rapide et efficace pour moi pour assimiler l’essentiel des cours , bien sûr avec toujours des petites recherches personnelles !!! Pour bien comprendre , Merci encore à vous et bonne continuation, on a besoin de vous pour nous accompagner dans ce cursus de droit.
Merci pour votre message. Oui les fiches de droit administratif sont disponibles ici : https://fiches-droit.com/pack-droit-administratif
bonjour Maxime ! Je serai intéressé par les fiches de révisions en vue de mes futures études en DUT carrières juridiques malheureusement le lien ne fonctionne pas! Bien à toi ARNAUD.
Je pense que cela fonctionne maintenant.
C’est excellemment bien fait
Très bonnes dissertation. Avez vous des dissertation en droit des assurances
Malheureusement non.

Suivez Fiches-droit.com sur les réseaux sociaux
Mentions légales
Conditions générales de vente
Politique de confidentialité
Liens utiles
La session a expiré
Veuillez vous reconnecter. La page de connexion s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre. Après connexion, vous pourrez la fermer et revenir à cette page.

100 citations – Phrases d’accroche pour exercices juridiques
100 citations juridiques dans 8 matières et thèmes : droit constitutionnel, introduction au droit, droit des biens, droit de la famille, droit de la responsabilité civile, droit administratif, droit pénal et la justice.
- Conçu et rédigé par une avocate de formation
- Format numérique PDF disponible immédiatement au téléchargement après la commande
9,90 €
Vous aimerez peut-être aussi…

Fiches – Introduction générale au droit (2024)

Fiches – Droit de la responsabilité civile (2024)

Fiches – Droit de la famille (2024)

Fiches + Flashcards – Introduction générale au droit (2024)

Fiches + Flashcards – Droit de la responsabilité civile (2024)

Fiches + Flashcards – Droit de la famille (2024)
Description, informations complémentaires.
A la recherche d’une phrase d’accroche pour une dissertation juridique, un commentaire de texte ou un commentaire d’arrêt ?
Découvrez 100 citations juridiques prêtes à l’emploi dans plus de 8 matières : droit constitutionnel, introduction au droit, droit des biens, droit de la famille, droit de la responsabilité civile, droit administratif, droit pénal et la justice.
Introduction
Les différents types de phrases d’accroche
100 Citations
- Droit constitutionnel
- Droit des biens
- Droit de la famille
- Droit de la responsabilité civile
- Introduction au droit
- Droit administratif
- Droit pénal
3 avis pour 100 citations – Phrases d’accroche pour exercices juridiques
ADJRO SADIA TAMBA – 27 juillet 2022
JE VEUX TELECHARGER CE LIVRE .IL EST INTERESSANTE
JE VEUX AVOIR DE TRES BONNE NOTE AUX TD
Arouna Dao – 11 septembre 2023
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *
Votre avis *
Enregistrer mon nom, mon e-mail et mon site dans le navigateur pour mon prochain commentaire.
A qui s’adresse ce livre ?
Ce livre est destiné aux étudiants en droit (licence, master, BTS, capacité en droit…) et aux candidats qui préparent un concours.
Pourquoi utiliser un recueil de citations juridiques ?
La réalisation des exercices juridiques nécessite de respecter la méthodologie imposée, et notamment de commencer par une phrase d’accroche pour susciter l’intérêt du correcteur. C’est la première impression que tu donnes de ton travail, i l est donc important de bien la choisir.
Pourtant, de nombreux candidats éprouvent des difficultés à trouver une phrase d’accroche pertinente. Faute d’inspiration et ne sachant pas où trouver de bonnes citations, ils y renoncent, ce qui peut leur coûter des points.
Grâce au livre 100 citations – Phrases d’accroche pour exercices juridiques :
- Tu ne perds plus de temps à rechercher des citations,
- Tu gagnes des points en utilisant des citations pertinentes pour tes devoirs tout en te distinguant des autres candidats !
Que contient ce livre ?
Au sein de ce livre sont listés les différents types de phrases d’accroche qui sont appréciés ou, à l’inverse, non appréciés par les correcteurs.
Le livre te propose une liste de 100 citations prêtes à l’emploi pour tes exercices juridiques (dissertation juridique, commentaire d’arrêt, commentaire de texte…) réparties en 8 matières et thèmes différents :
- Droit de la responsabilité civile
- Droit pénal
Il ne s’agit pas de citations issues de manuels de droit récents rédigés par des professeurs d’université, mais de citations d’auteurs, de philosophes, d’hommes politiques, d’historiens, etc… (exemples : Aristote, Montesquieu, Benjamin Constant, Abraham Lincoln, Ernest Renan, Platon, Carbonnier,…).
Notre ouvrage peut être utilisé par toutes les personnes qui étudient le droit : étudiants ou candidats aux concours juridiques.
Oui, le livre est au format PDF imprimable (A4).
Tous nos outils sont conçus et rédigés par Amandine BERTAUT, avocate de formation.
Consultez notre page « A propos » pour en savoir plus !
Tous nos outils sont au format numérique.
Il n’y a aucun délai de livraison : le produit est immédiatement disponible au téléchargement après le paiement.
Oui, le paiement est sécurisé. Il peut être effectué par carte bancaire ou par PayPal.

EN SAVOIR PLUS
Reseaux sociaux, © maître du droit™, 2024 - tous droits réservés.

L'école Jurixio
Exemple de dissertation juridique (droit administratif)
Dans cet article, tu trouveras une dissertation juridique de droit administratif écrite par une étudiante de L2 droit (Léa) et ayant obtenu la note de 17/20.
Sujet de dissertation juridique de droit administratif (L2 droit) : “Le juge administratif, gardien des traités ?”
Introduction
Lors d’un colloque sur l’internationalisation du droit administratif organisé au Centre de droit public comparé de l’Université Paris II Panthéon-Assas en 2018, le président de section du Conseil d’État Bernard Stirn a déclaré : « Les rapports du Conseil d’État avec le droit international sont moins marqués par la résistance que par la réception, l’entraînement, l’enrichissement et l’interaction ». Cette déclaration témoigne de l’évolution progressive du droit international en droit interne français et de la nécessité actuelle de concilier les différentes sources du droit applicables en France.
Le droit administratif se définit comme l’ensemble des règles applicables aux activités de l’administration. Étant un droit autonome, celui-ci est marqué par le rôle fondateur et indispensable du juge administratif qui, par sa jurisprudence, dégage des principes fondateurs et dispose d’un pouvoir d’interprétation conséquent. Ce rôle d’interprétation du juge administratif lui permet, au-delà de construire véritablement le droit administratif, de faire respecter ce qu’on appelle la hiérarchie des normes. Hans Kelsen est à l’origine de ce principe de hiérarchie qui permet d’affirmer que certaines sources juridiques prévalent sur d’autres. Or, cette hiérarchie des normes en droit français a été redéfinie à partir du développement du droit international et de la multiplication des traités internationaux. En effet, ces accords qui ont pour effet de produire des effets juridiques à l’égard de plusieurs États qui ont manifesté leur volonté de créer des obligations réciproques entre eux, s’insèrent directement dans notre ordre interne et donnent ainsi le pas à une conception moniste. Cette idée a été affirmée dès la Constitution du 27 octobre 1946 qui disposait que : « La République Française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international ». C’est ainsi qu’une évolution progressive de la place du droit international s’est enclenchée dans l’ordre juridique français.
À l’instar de cette évolution progressive qui semble bouleverser les traditions et les conceptions françaises, il est nécessaire de s’interroger sur la place des sources du droit international dans notre ordre interne ainsi que sur la façon dont les juges judiciaires et administratifs se sont accommodés à cette nouveauté particulière. En effet, le juge administratif français a pris du temps pour accepter et défendre le droit international en tant que source de notre droit interne. La situation actuelle de la France aux regards des évolutions du droit international semble être réglée depuis la Constitution de 1958 qui dispose dans son article 55 que les traités ont une autorité supérieure à celle de la loi. Ainsi, la place des traités internationaux dans la hiérarchie des normes ne fait aucun doute. Cependant, il faut néanmoins s’interroger sur la façon dont les juges parviennent à faire respecter cette disposition.
C’est pourquoi il est nécessaire de se pencher sur la question du rôle du juge administratif relativement au droit international qui semble avoir un rôle important dans sa mise en œuvre comme dans sa protection. Ainsi, dans quelle mesure le juge administratif participe-t-il de façon importante à l’évolution et à l’imbrication du droit international dans l’ordre juridique français ?
Le juge administratif dispose d’un rôle indispensable relativement au respect de l’application des sources du droit international (I), mais d’autre part apparait également la nécessité de conditionner cette application (II).

pour aller plus loin…
Dissertation juridique facile™.
Obtenez la moyenne (voire plus) à toutes vos dissertations juridiques grâce à un programme complet élaboré par Jurixio.
I/ Un rôle apparent du juge administratif dans l’application des traités
Le droit international fait partie intégrante de la hiérarchie des normes en droit français et constitue ainsi une source de droit applicable dans l’ordre interne, et plus particulièrement dans l’ordre administratif (A). Cependant, en vertu de cette nouvelle place prépondérante des traités, il est nécessaire d’assurer un contrôle afin de faire respecter la hiérarchie des normes (B).
A) Le nécessaire respect du principe de légalité
En droit administratif français, il existe un principe de légalité en vertu duquel le juge administratif doit s’assurer du respect par l’administration des sources de droit qui s’appliquent à elle et auxquelles elle est dès lors soumise. Or, depuis l’internationalisation croissante et la place du droit international dans la hiérarchie des normes en France, le juge administratif doit donc également s’assurer du respect des traités, qui constituent à présent une source externe du droit administratif français. En effet, le Conseil d’État a affirmé en 2014 dans un arrêt dit Giorgio que l’ensemble des obligations internationales souscrites par la France doivent être respectées par l’administration.
De plus, dans un arrêt d’Assemblée de 2007, Société Arcelor, le Conseil d’État a encore une fois démontré la nécessité de respecter les sources externes du droit administratif relativement à la question d’une directive européenne. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un traité, cette décision démontre la volonté pour le juge administratif de faire respecter l’ensemble des sources du principe de légalité. En effet, dans cet arrêt le Conseil d’État a dû se prononcer sur la conformité d’un décret de transposition d’une directive. Or, celui-ci a refusé de trancher et a renvoyé la question à la Cour de Justice de l’Union Européenne en considérant que juger la conformité du décret reviendrait à juger la directive européenne elle-même. Cette décision démontre bien la volonté du juge administratif d’intégrer en droit français les sources du droit international et du droit de l’union européenne.
Enfin, l’arrêt Ministre de l’Intérieur contre Commune de Calais rendu par le Conseil d’État en 2015 démontre encore une fois que le droit international est une source de droit applicable à l’administration. En effet, dans cette décision, le Conseil d’État va ordonner à la commune de réaliser des travaux afin de remédier à la situation d’un camp de migrants en vertu de l’article 3 de la Convention Européenne des droits de l’homme et de la théorie des obligations positives dégagée par la Cour Européenne des droits de l’homme.
Cependant, contrairement à sa position dans l’arrêt Société Arcelor, le juge administratif va par la suite se considérer compétent pour juger lui-même de la conformité des actes administratifs aux traités internationaux.
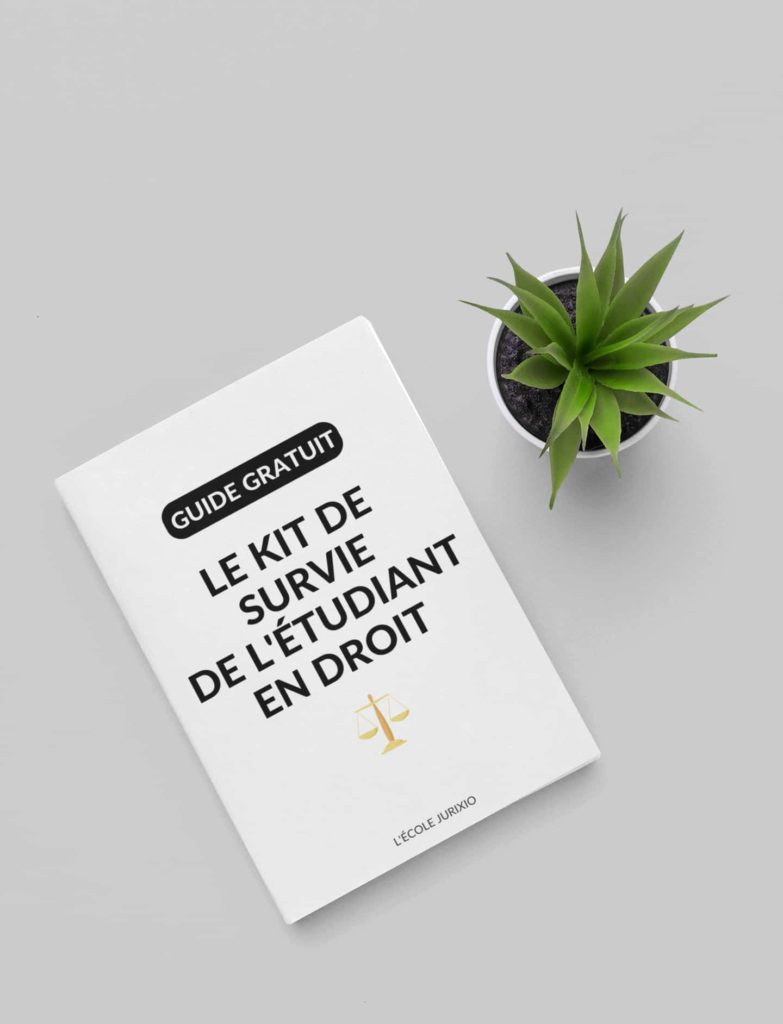
Devenez un étudiant que l’on remarque
Le kit de survie de l’étudiant en droit.
Un guide pour réussir ses années de droit (et ses concours), avoir un excellent dossier et se démarquer des autres.
B) Le nouveau contrôle de conventionalité du juge administratif
Suite à l’intégration en droit français des sources du droit international, la question s’est posée de savoir quelle serait la juridiction compétente pour juger de la conformité des actes administratifs ou des lois aux traités internationaux. Dans une décision de 1975 dite Interruption volontaire de grossesse, le Conseil Constitutionnel a estimé qu’un tel contrôle de conventionalité des lois ne lui revenait pas. Suite à cela, la Cour de Cassation s’est considérée compétente pour exercer un tel contrôle. C’est un peu plus tard, en 1989, que le Conseil d’État va suivre le pas et annoncer dans un arrêt Nicolo que le juge administratif est compétent pour écarter l’application d’une loi nationale qui serait contraire à une convention internationale.
Ainsi, il apparait qu’en plus d’affirmer que les traités sont une source applicable au droit administratif français, le juge administratif va plus loin et prend en charge le contrôle de conformité des lois nationales au droit international, et c’est en cela que le juge administratif apparait comme un véritable gardien des traités. Dans un arrêt d’Assemblée de 1992, appelé Société Arizona Tobacco et Phillip Moris, le Conseil d’État va déclarer que le pouvoir réglementaire est responsable d’une loi déclarée inconventionnelle. De plus, dans un arrêt d’Assemblée de 2007 dit Gardedieu, le Conseil d’État va déclarer une loi inconventionnelle et affirmer à cet égard la responsabilité de l’État français.
Ainsi, le juge administratif à travers sa jurisprudence va tout d’abord démontrer que le droit international est bel et bien une source du droit administratif, ce qui permet d’ores et déjà de démontrer que celui-ci assure le respect et l’imbrication du droit international en France. De plus, il va assurer lui-même le contrôle de conventionalité des lois internationales aux traités via l’exception d’inconventionnalité et avoir ainsi un véritable rôle de gardien des sources du droit international. Cependant, ce rôle majeur du juge administratif fonctionne dans ce sens comme dans l’autre : en effet, celui-ci va également apparaitre comme le gardien de l’ordre interne.
II/Un rôle apparent du juge administratif dans le contrôle des conditions relatives à l’application des traités
Bien que le juge administratif assure le respect des sources externes dans l’ordre juridique interne, ce dernier a également un rôle majeur relativement à la nécessité de poser des conditions à l’application de ces sources externes. En effet, il veille à une application conditionnée des traités (A) et dispose également d’un rôle d’interprétation important (B).
A) Une application conditionnée des traités
Les sources externes doivent respecter des conditions pour être applicables en France, au même titre que les sources internes qui doivent être entrées en vigueur et publiés. En effet, en vertu de la Constitution de 1958, les traités doivent être régulièrement ratifiés ou approuvés. De plus, certains particulièrement importants doivent être ratifiés en vertu d’une loi, tel que le prévoit l’article 53 de la Constitution. Relativement à cette condition, le juge administratif s’est déclaré compétent pour contrôler qu’une autorisation préalable du législateur existe bien dans un arrêt d’Assemblée de 1998 dit SARL du parc d’activité de Blotzheim.
De plus, il existe une condition de réciprocité qui autorise un État à refuser d’exécuter ses engagements dès lors que l’autre État n’exécute pas ses propres obligations. Le Conseil d’État s’est là encore déclaré compétent pour vérifier si la condition de réciprocité était remplie dans un arrêt d’Assemblée de 2010 dit Cheriet-Benseghir. Le juge administratif a donc un rôle prépondérant dans l’application conditionnée des traités car il a pour rôle de vérifier les conditions d’application nécessaires. Enfin, dans un arrêt d’Assemblée de 2012 dit GISTI et FAPIL, le juge administratif va déclarer qu’une stipulation internationale aura un effet direct seulement si elle n’a pas pour objectif de régir des relations entre État et si celle-ci ne requiert pas d’acte complémentaire pour produire des effets. Ainsi, en plus de contrôler les conditions déjà exposées par la Constitution, le juge administratif rajoute une condition relativement aux dispositions internationales.
L’arrêt GISTI et FAPIL permet de mettre une autre prérogative importante du juge administratif : en effet, celui-ci dispose d’un pouvoir d’interprétation important qui lui permet de dégager des conditions en l’espèce mais également des principes.
B) Le pouvoir d’interprétation du juge administratif
Le juge administratif assure le respect des sources externes, au même titre qu’il veille au respect des conditions nécessaires à son application en droit interne, mais son rôle va encore plus loin car celui-ci est compétent pour interpréter directement une disposition internationale. Dès 1990, dans un arrêt d’Assemblée GISTI, le Conseil d’État va en effet se considérer comme compétent pour interpréter les conventions internationales. Cet arrêt est majeur car auparavant, le juge administratif refusait d’interpréter lui-même une convention et renvoyait cela au Ministre des affaires étrangères par le biais d’une question préjudicielle. C’est suite à l’arrêt Nicolo de 1989 précité que le juge administratif a décidé d’abandonner cette jurisprudence.
Ce pouvoir d’interprétation va permettre au juge administratif de mettre en avant toutes les conséquences qu’une disposition internationale entraine. Il va d’une part lui permettre de contrôler plus vigoureusement que les conditions nécessaires à son application en droit interne sont remplies, mais d’autre part cela va lui permettre d’être plus efficace dans son contrôle de conventionalité des dispositions françaises relativement au droit international. Il faut donc nuancer le propos selon lequel le juge administratif aurait un rôle « préventif » via son contrôle de respect des conditions nécessaires à l’application du droit international. Dans un arrêt d’Assemblée de 2016 dit Gomez, le Conseil d’État va même jusqu’à juger une loi française comme inconventionnelle relativement aux conséquences de son application à une personne en particulier dans le cadre de l’atteinte à la vie privée et familiale.
En définitive, le juge administratif semble avoir un rôle véritablement majeur dans l’évolution du droit international dans notre ordre interne bien qu’il soit également chargé de limiter l’application de ce droit en vérifiant le respect de conditions. Le temps des querelles entre le juge administratif et les sources externes du droit semble donc être révolu : les normes nationales comme internationales sont directement insérées dans notre ordre interne, donnant ainsi une conception moniste à la hiérarchie des normes française. De plus, le dialogue entre les juges semble être également un moyen important de l’évolution du droit international ainsi que nous l’avons vu avec l’arrêt Arcelor de 2007 précité.
Cette dissertation juridique de droit administratif a été rédigée ainsi par l’étudiante. Aucun changement n’a été apporté, ni sur la forme ni sur l’orthographe.
Pour aller plus loin…
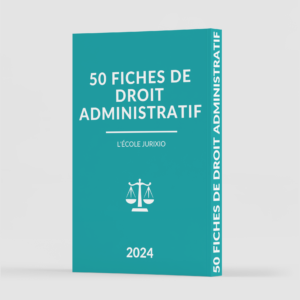
Fiches de droit administratif (2023/2024) – Le pack intégral de 50 fiches

Flashcards de droit administratif (2023/2024)
Jurixio est actuellement enseignant en droit à l'Université Catholique de Lyon (UCLy).
Il est le créateur de "Jurixio - Les vidéos de droit", la chaine YouTube n°1 sur les études de droit en France.
Au cours de ses études de droit, il a obtenu la mention à chacune de ses années.
Sur L'école Jurixio, il transmet sa passion et partage ses astuces efficaces (fiches de droit, cours, méthodologie...) pour permettre aux étudiants de briller à la fac de droit.
Il propose aussi de nombreux outils pour gagner du temps dans les révisions, avoir le meilleur dossier possible et réussir ses concours.
Publications similaires

La méthodologie de la dissertation en droit (2023) – Réussir sa dissertation juridique
La dissertation en droit est l’un des exercices phares des études de droit. Durant toute la licence et même en Master,…

La méthodologie du cas pratique en droit (avec exercice corrigé)
Exercice incontournable des études de droit, le cas pratique semble simple sur le papier. Des étapes à respecter, un ordre bien…

Exemple de cas pratique droit des contrats (avec corrigé)
Exemple de cas pratique en droit des contrats accompagné d’un corrigé détaillé.
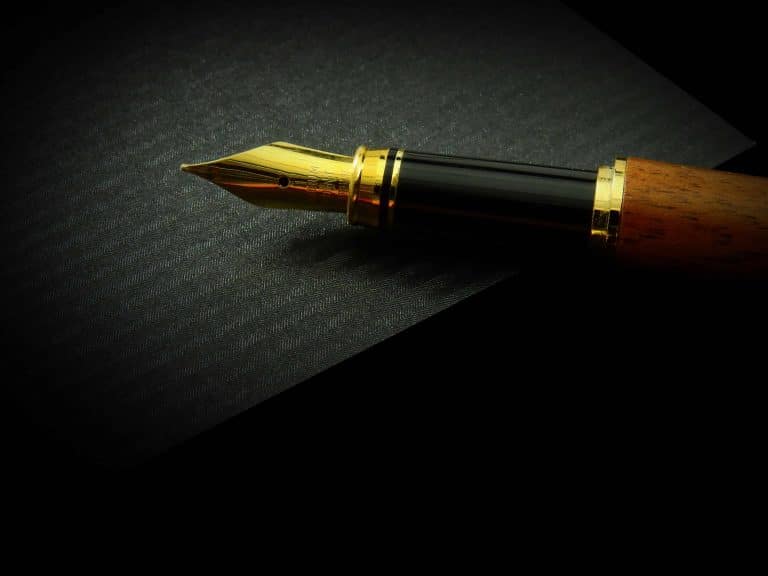
Cas pratique en droit constitutionnel corrigé
Vous avez un cas pratique en droit constitutionnel à faire mais vous ne savez pas comment vous y prendre ? Vous êtes au…

Exemple de dissertation juridique (droit civil)
Dans cet article, vous trouverez une dissertation juridique de droit civil écrite par une étudiante de L1 droit et ayant obtenu…

La méthodologie du commentaire de texte en Droit – Le guide complet (2023)
Vous devez faire un commentaire de texte en droit constitutionnel ou en histoire du droit mais vous ne savez pas comment…
Laisser un commentaire Annuler la réponse
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *
Enregistrer mon nom, mon e-mail et mon site dans le navigateur pour mon prochain commentaire.
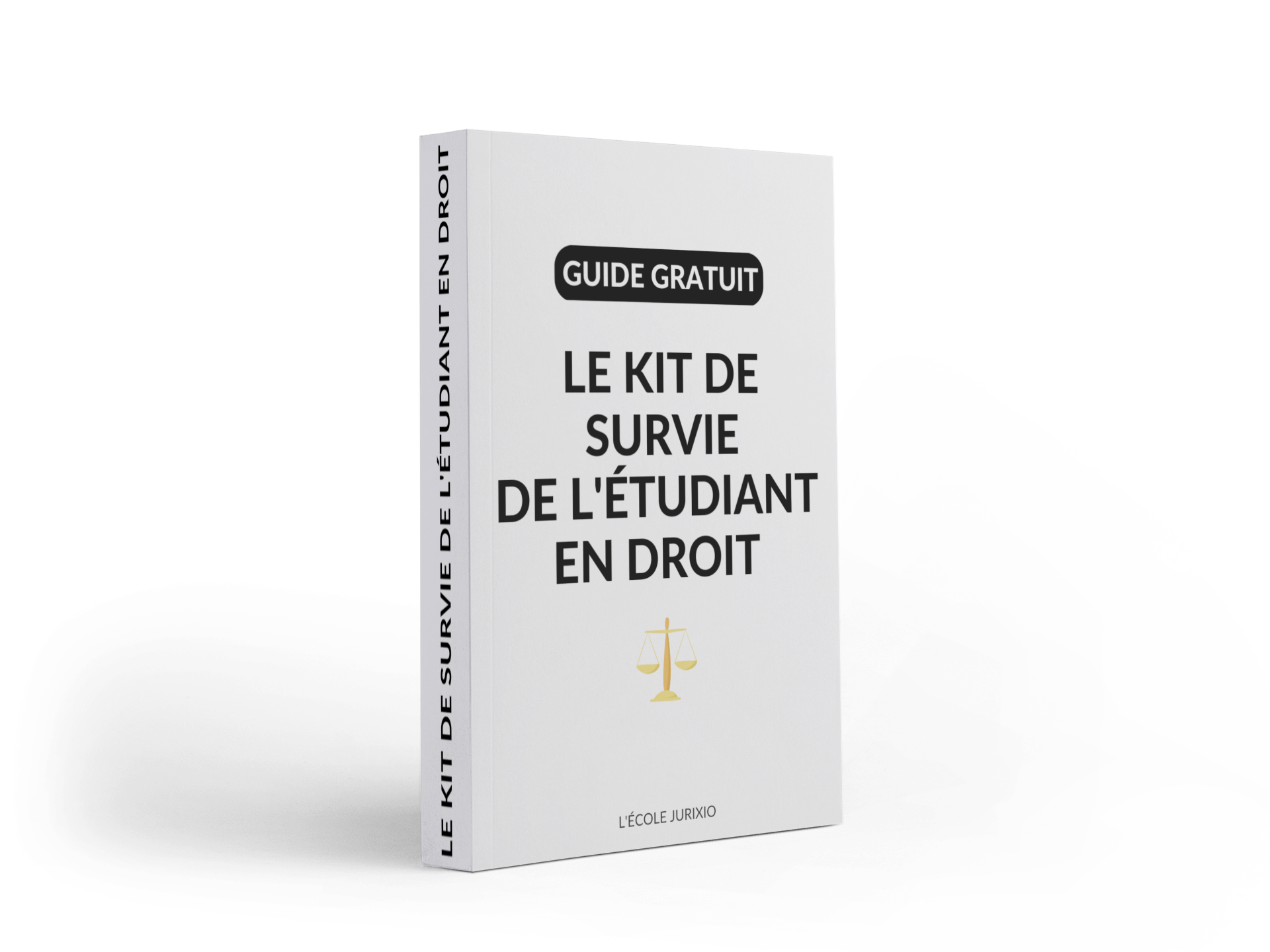
Devenez un étudiant que l’on remarque.
Téléchargez gratuitement le kit de survie de l’étudiant en droit en cliquant ci-dessous.
- Votre panier
Vous n'avez pas encore ajouté de produit.
Une méthode de la dissertation juridique
Par Louise GUINARD :: L'Université
Le mois de décembre a quelque chose de spécial pour les étudiants en droit… il annonce l’arrivée imminente d’une période des plus redoutables : les examens du premier semestre. Face à ce contexte si particulier, il est apparu intéressant de consacrer le billet de la chronique de ce mois-ci à la méthode de la dissertation juridique, afin de venir ajouter aux précédentes méthodes du commentaire d’arrêt et du commentaire d’arrêts comparés déjà accessibles sur le blog.
Le mois de décembre a quelque chose de spécial pour les étudiants en droit… il annonce l’arrivée imminente d’une période des plus redoutables : les examens du premier semestre. Face à ce contexte si particulier, il est apparu intéressant de consacrer le billet de la chronique de ce mois-ci à la méthode de la dissertation juridique, afin de venir ajouter aux précédentes méthodes du commentaire d’arrêt et du commentaire d’arrêts comparés déjà accessibles sur le blog.
À l’instar des deux précédentes, la présente méthode ne prétend pas être LA méthode de la dissertation juridique et n’a pas pour but de se substituer à la méthode dispensée par vos différents enseignants. Elle vise simplement à apporter un peu d’aide aux étudiants qui seraient susceptibles d’en ressentir le besoin.
I. Remarques générales sur l’exercice de la dissertation juridique
Sur la forme, un sujet de dissertation peut se présenter de différentes façons. Il peut s’agir d’un mot, d’un ensemble de mots voire d’une phrase, parfois à la forme interrogative.
Quelle que soit la forme du sujet, l’objectif de la dissertation est le même : il est d’ amener les étudiants à structurer un raisonnement sur un sujet en lien avec le cours, et ce, à l’aide de riches connaissances tout en suivant une certaine méthodologie . Le but de la dissertation n’est donc assurément pas de réaliser un copier-coller du plan et des développements du cours. Pourtant, il s’agit là d’un écueil récurrent.
Afin de réaliser l’exercice de la dissertation juridique avec succès, plusieurs ingrédients sont nécessaires :
- 1 er ingrédient : les connaissances . La dissertation juridique est un exercice qui nécessite la mobilisation de nombreuses connaissances acquises grâce aux cours, TD et lectures personnelles (ouvrages, articles de doctrine, etc.). Maîtriser parfaitement ce qui a été vu en cours et en TD est donc indispensable pour réaliser une bonne dissertation. Dès lors, un travail régulier de compréhension et d’apprentissage du cours constitue un préalable indispensable à la réalisation de la dissertation juridique.
- 2 è ingrédient : la réflexion . Les connaissances ne sauraient suffire à la réalisation de l’exercice. Tout l’intérêt de la dissertation est d’amener les étudiants à réfléchir grâce à leurs connaissances. Pour le dire autrement, les connaissances ne constituent qu’un outil qui va permettre de construire une démonstration sur le sujet.
- 3 è ingrédient : l’entraînement . Il n’y a pas de secret, la méthodologie de la dissertation s’acquiert avec l’expérience. Outre la compréhension et l’apprentissage du cours, qui constituent un préalable indispensable, la maîtrise de l’exercice nécessite plusieurs entraînements réguliers (d’où l’intérêt de réaliser l’exercice demandé à chaque séance de TD, ce qui permet ensuite de comparer son travail avec la correction proposée…).
Telle une bonne recette, ce n’est que le mélange adéquat de ces trois ingrédients qui permettra de réaliser une bonne dissertation . Aussi, suffit-il que l’un ou plusieurs de ces ingrédients manquent ou soient apportés en quantité insuffisante pour que l’ensemble soit déséquilibré.
Si ces trois ingrédients, que sont les connaissances, la réflexion et l’entraînement, ne sont le fruit que de votre travail, certaines petites astuces méthodologiques peuvent vous aider. Voyons pour cela les étapes que vous devez suivre : le travail de réflexion tout d’abord, le travail de rédaction ensuite.
II. Le travail de réflexion
Le travail de réflexion sur le sujet de dissertation correspond à la phase de travail qui se déroule au brouillon.
1°) La première étape consiste à découvrir l’énoncé du sujet, qu’il va falloir lire très attentivement , en identifiant les termes importants, les mots de liaisons ainsi que la ponctuation. La lecture attentive du sujet est fondamentale puisqu’elle permet de déterminer quel est le sens du sujet.
2°) La deuxième étape consiste à définir les termes essentiels du sujet , et notamment ceux qui sont en rapport avec le thème du cours et qui y ont en principe été définis. Cette deuxième étape permet d’identifier l’objet du sujet, ses limites et à quelle(s) partie(s) du cours il se rattache.
3°) La troisième étape se caractérise par la réalisation d’une fiche de connaissances . La fiche de connaissances vise à recenser toutes les connaissances dont vous disposez et qui sont en lien avec le sujet. Dans un premier temps, il convient de jeter sur le papier les idées telles qu’elles viennent. Puis, dans un second temps, il convient de trouver une certaine logique à ces différentes idées afin de pouvoir les regrouper, les classer.
Petite astuce : afin d’éviter les oublis, lorsque vous réalisez votre fiche de connaissances, reprenez mentalement le plan du cours et les différents thèmes des séances de TD (que vous devez connaître par cœur…), pour aller y chercher, dans leurs développements, les notions, arrêts et remarques qui pourront vous être utiles pour traiter le sujet.
4°) La quatrième étape prend appui sur les précédentes et se matérialise par la recherche d’une problématique . Malheureusement, il n’existe pas de problématique « type » car celle-ci va dépendre du sujet. Cela étant, de manière générale, il s’agit de trouver la question qui se cache derrière le sujet et qui explique pourquoi ce dernier vous a été donné. Cela implique d’avoir une bonne compréhension ainsi qu’une bonne connaissance du sujet. Il faut essayer de trouver une question qui engage à la discussion, à laquelle on ne peut pas apporter de réponse trop évidente.
La problématique est fondamentale car elle constitue le cœur de la dissertation. Il faut donc y consacrer du temps et la formuler le plus simplement et le plus clairement possible. Il faut également faire attention à ce qu’elle englobe tout le sujet mais rien que le sujet. Pour cela, il peut être bon de reprendre les termes essentiels du sujet – que vous avez préalablement définis – pour formuler votre problématique.
5°) Pour la cinquième étape , une fois la problématique posée – et seulement à ce moment – il va falloir s’atteler à la recherche du plan .
Classiquement, un plan comporte deux parties (I./II.), elles-mêmes découpées en deux sous-parties (A./B.). Il s’agit d’un plan suffisamment découpé pour pouvoir y organiser ses idées sans trop de difficultés, mais sans toutefois l’être à l’excès, ce qui pourrait compliquer l’organisation des idées et rendre le travail de recherche du plan plus complexe qu’il ne l’est déjà.
Le plan constitue la structure de votre raisonnement (les deux grandes étapes de raisonnement en I. et II., et les deux sous-étapes de raisonnement en A. et B.). Il n’est donc absolument pas question de reprendre les intitulés du cours pour formuler les titres de parties et de sous-parties. De plus, à la lecture du plan, la réponse donnée à la problématique doit apparaître. Afin d’être sûrs de répondre à votre problématique et de traiter le sujet, il peut être bon de reprendre les termes essentiels de la problématique – eux-mêmes tirés de l’énoncé du sujet – pour formuler les titres de parties (I./II.).
Concernant la formulation des intitulés, outre le fait qu’ils doivent répondre à la problématique, ils doivent synthétiser le plus brièvement possible les idées développées dans les parties et sous-parties, à l’image d’un titre de chapitre dans un ouvrage. On doit ainsi comprendre, dans l’ensemble, ce qui va être développé au sein de chaque partie et sous-partie à la seule lecture de leur intitulé. Pour cela, il faut adopter un style sobre, clair et concis . Un intitulé doit se comprendre en une seule lecture et être relativement bref, ce qui explique que les verbes conjugués soient généralement proscrits car leur utilisation a tendance à rallonger les intitulés.
6°) Sixième étape , une fois la recherche du plan terminée, il convient de réaliser un plan détaillé .
Le plan détaillé vise tout simplement, en vous appuyant sur la fiche de connaissances, à organiser clairement et logiquement vos différentes idées et connaissances au sein de chaque sous-partie.
7°) Enfin, dernière étape , une fois que vous avez votre problématique et votre plan détaillé, vous pouvez terminer le travail au brouillon par la mise en forme de l’introduction .
N.B. : terminer par l’introduction vous permet de savoir ce qu’il faut y inclure ou non, en fonction de ce que vous avez inséré dans votre plan. Néanmoins, si vos idées sont claires dès le départ, il est envisageable de mettre en forme l’introduction juste après avoir trouvé la problématique et le plan.
L’introduction suit généralement la trame suivante :
- 1°) Phrase d’accroche : la phrase d’accroche peut consister en une citation, une actualité, une décision de justice, etc. L’essentiel est qu’elle soit en lien avec le sujet et teintée d’une certaine originalité . L’accroche vise à montrer que vous avez cerné l’intérêt du sujet, sans en dire trop, tout en piquant la curiosité de votre lecteur. Si vous décidez d’user d’une citation ou d’une actualité, il faut impérativement l’expliquer et montrer le lien qu’elle présente avec le sujet, avec ce sur quoi il interroge. Il ne s’agit donc pas de mentionner une citation sans l’expliquer pour passer ensuite à la définition des termes du sujet.
- 2°) Définition et délimitation du sujet : il s’agit ici de reprendre la définition des termes essentiels du sujet et de justifier, si le sujet peut être entendu plus ou moins largement, les éventuels choix de délimitation.
- 3°) Contextualisation et intérêt du sujet : concernant la contextualisation , il s’agit de développer le contexte historique du sujet, mais également de faire référence, si le sujet s’y prête, aux différentes branches du droit et au droit comparé. Concernant l’intérêt du sujet, il s’agit de développer les difficultés auxquelles le sujet se heurte, afin d’amener progressivement votre problématique.
- 4°) Problématique : il s’agit ici, à la suite de la contextualisation et de l’intérêt du sujet, d’insérer élégamment la problématique, dans la continuité des développements précédents.
- 5°) Annonce de plan : intervenant juste après la problématique, l’annonce de plan doit en constituer la réponse tout en annonçant vos parties (I./II.). Dit autrement, il s’agit d’expliquer de quelle manière vous allez répondre à votre problématique, en exposant les deux grandes étapes de votre raisonnement que sont votre I. et votre II. Il n’y a rien de compliqué à cela : vous savez tous formuler une réponse à une question. Si, à la lecture, l’annonce de plan ne répond pas à la problématique, soit il y a un problème dans la formulation de l’annonce de plan, soit le plan est déconnecté de la problématique…
En résumé, au stade de l’introduction, il faut surtout veiller à organiser vos idées de façon cohérente, en partant du plus général (les définitions) tout en resserrant progressivement sur l’intérêt du sujet et votre problématique. Il faut bien avoir en tête que l’introduction constitue une partie importante de la dissertation. Il faut donc qu’elle soit suffisamment développée afin de montrer que le sujet est compris, que vous disposez de solides et nombreuses connaissances sur le sujet, et que vous allez discuter ce dernier.
Une fois le travail au brouillon fini, il convient de passer au travail de rédaction.
III. Le travail de rédaction
L’essentiel du travail ayant été fait au brouillon, le travail de rédaction est en principe essentiellement un exercice de mise en forme, de mise au propre du travail de réflexion.
La rédaction commence par l’introduction qu’il va falloir rédiger en un seul « bloc », c’est-à-dire que les différentes étapes de l’introduction qui vous ont servi à la construire et à l’organiser au brouillon ne doivent pas être annoncées. Par exemple, ne dites pas « La phrase d’accroche est la suivante… », « Pour les définitions, nous allons voir que… », « L’annonce de plan est la suivante… », etc. Les différentes étapes vues précédemment doivent s’enchaîner naturellement, la fin de l’une amenant le début de l’autre.
Quant au corps de la dissertation, il est composé :
- Du plan qui doit être apparent . Cela signifie que les titres de parties et de sous-parties doivent apparaître clairement sur la copie.
- Les chapeaux sont des annonces de plan qui interviennent après les titres de parties (I./II.) et avant ceux des sous-parties (A./B.). Il y en a donc deux au total : l’un après l’intitulé du I. et l’autre à la suite de l’intitulé du II. Ils doivent vous permettre d’annoncer vos sous-parties (A./B.), tout en expliquant brièvement la logique de votre découpage, mais sans toutefois déborder sur les développements.
- Les transitions sont des phrases qui permettent de faire le lien entre votre I. et votre II., ainsi qu’entre vos A. à vos B. Il ne s’agit pas d’une conclusion, mais d’une ou deux phrases qui visent à expliquer le déroulement logique de votre raisonnement.
- Des développements : les développements ont pour but de développer les idées qui ressortent des intitulés, afin d’apporter une réponse à la problématique. Il ne s’agit donc pas de restituer le cours, mais d’exposer sa propre démonstration sur le sujet, en s’appuyant sur les connaissances vues en cours et en TD. Au sein des développements, il faut veiller à organiser rigoureusement vos idées afin que l’on puisse suivre la logique du raisonnement. Votre réflexion doit s’affiner à mesure que le développement avance. Pour cela, il convient de commencer par exposer une idée, de l’éclairer ensuite par des notions, des définitions, des connaissances et de l’appuyer enfin par des exemples. Toute idée avancée doit donc être justifiée et appuyée par des connaissances et des exemples.
Pour finir, il n’est en principe pas nécessaire de conclure, au risque sinon d’être redondant. En revanche, la dissertation s’achève sur ce que l’on appelle une ouverture . Il s’agit d’ouvrir la réflexion sur un autre « problème » que celui que vous avez traité, qui est connexe au sujet et qui s’inscrit dans la continuité de la réflexion que vous avez tenue sur le sujet.
7 juin 2022

Louise GUINARD
Louise Guinard est doctorante en droit public à l’Université de Rennes 1. Elle est diplômée du Master 2 Droit public général de l’Université de Rennes 1, au cours duquel elle a réalisé un mémoire de recherche portant sur la coexistence des recours en matière de répression administrative, qui a été récompensé par le prix Planiol…
Partager ce billet
Commentaires.
Merci infiniment
Merci beaucoup !
merci beaucoup. ça m’interesse
Merci beaucoup
Laisser un commentaire Annuler la réponse
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *
Commentaire *
Enregistrer mon nom, mon e-mail et mon site dans le navigateur pour mon prochain commentaire.
Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées .
Les auteurs
Directeur de publication : François GILBERT
Comité de rédaction : Mathilde HEITZMANN-PATIN , Marie-Odile PEYROUX-SISSOKO , Jean-Baptiste CHEVALIER , Julien LALANNE , François CURAN et Louise GUINARD
Comité scientifique : Alexandre CIAUDO , Florian POULET et Alexis FRANK
et leurs aimables invités .
Le blog Droit administratif
Table des matières
à retenir.
- Essai sur un système juridique d’il y a longtemps, dans une galaxie très lointaine
- Une méthode du commentaire d’arrêt
- Les « grands » articles du droit administratif général
- Les revues de droit public
- Les Masters 2 de droit public
Catégories
- Chronique mensuelle
- Contentieux administratif
- Droit administratif des biens
- Droit administratif général
- Droit de l'environnement
- Droit de l'urbanisme
- Droit de la commande publique
- Droit de la santé publique
- Droit des étrangers
- Droit électoral
- Droit et cinéma
- Droit et contentieux constitutionnel
- Droit fiscal
- Droit public comparé
- Droit public des affaires
- Fonction publique
- L'Université
- La profession d'avocat
- La profession de conseiller de TA et CAA
- Libertés publiques
- Police administrative
- Politique et analyse institutionnelle
- Revue bibliographique
- Vie du blog
Revues numériques et blogs sur le droit administratif
- Actualité du droit des étrangers
- Le Journal du droit administratif
- Revue générale du droit (RGD)
Sites sur le droit administratif
- Association française pour la recherche en droit administratif (AFDA)
- Bibliothèque numérique de droit public des affaires (BNDPA)
Autres blogs juridiques de droit public
- Jus Politicum blog
Autres ressources utiles
- Conseil d'État
- Les essentiels du droit de Gallica
ISSN 2262-9920
Syndication.
- fil rss commentaires
- fil atom commentaires
Mentions Légales

Dissertation juridique corrigée – Les critères du contrat administratif
Cette dissertation juridique corrigée porte sur un chapitre essentiel du cours de droit administratif : les critères d’identification du contrat administratif .
Ce devoir réalisé par Louna a reçu la note de 12.5/20 !
Sujet : les critères du contrat administratif
« Le contrat administratif suppose essentiellement deux contractants, qui se reconnaissent placés sur un pied d’inégalité » a dit Gaston Jèze. En effet, le contrat administratif se caractérise notamment par les pouvoirs exorbitants qu’il confère à l’administration.
Un contrat administratif est un contrat passé par une personne publique soumis au droit administratif, soit par disposition expresse de la loi, soit en raison de la présence de clauses exorbitantes du droit commun dans ses stipulations, soit parce qu’il confère à son titulaire une participation directe à l’exécution d’une activité de service public. Ainsi, tous les contrats de personnes publiques ne sont pas des contrats administratif, certains étant soumis aux règles du droit privé.
Les contrats de droit privé sont soumis au droit commun des obligations. Cependant, les contrats en droit administratif sont des contrats de droit public et sont donc soumis à la juridiction administrative et à des règles spéciales. La qualification d’un contrat choisi par les parties importe peu, puisqu’en cas de litiges c’est le juge qui déterminera le type de contrat, en se référant soit à une qualification législative soit à une qualification jurisprudentielle. Le législateur peut qualifier indirectement un contrat, en déterminant la juridiction compétente, ou expressément.
Ainsi, il est intéressant de se demander par quels critère le contrat administratif se distingue-t-il du contrat privé ?
Le premier critère qui sera observé par le juge est le critère organique (I) , et s’il est rempli, il se penchera alors sur le critère alternatif, aussi appelé critère matériel (II) .
- L’invocation du critère organique
Pour qu’un contrat soit administratif, il faut qu’au moins une des parties soit une personne publique (A) . Néanmoins, il existe certains cas ou un contrat conclu entre personnes privées est administratif (B) .
- La nécessité d’une personne publique
Le principe est que tout contrat entre personnes publiques est un contrat administratif, soumis aux juridictions administratives . C’est la présomption d’administrativité d’un contrat passé entre deux personnes de droit public affirmée par le tribunal des conflits dans l’arrêt « UAP » rendu le 21 mars 1983 . Cependant, le Tribunal des conflits, dans un arrêt du 3 mars 1969, a affirmé que si un contrat conclu entre personnes publiques ne fait naître aucune de relation de droit public, alors c’est un contrat privé. La personne publique partie au contrat peut être représentée par une personne privée, par le biais d’un mandat, ne changeant pas la nature du contrat.
Ce principe a été établi par le conseil d’Etat dans l’arrêt « Prades » du 18 décembre 1936. Le mandat n’est pas nécessairement formel. En effet, d’après l’arrêt « société d’équipement de la région montpelliéraine » du conseil d’Etat du 30 mai 1975, confirmé par le Tribunal des Conflits dans sa décision, « commune d’Agde », du 7 juillet 1975, cela vaut également lorsque le mandat est tacite ou implicite, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a qu’un faisceau d’indices ou de circonstances permettent de démontrer que la personne privée agit pour le compte d’une personne publique. De plus, les contrats accessoires de contrats administratifs sont eux-mêmes de contrats administratifs, même s’ils sont passés entre deux personnes de droit privé, mais le cas est assez rare. Le contrat accessoire est un contrat qui n’existe que par rapport à un autre contrat, le contrat principal.
Il existe cependant des contrats administratifs conclus entre personnes privées (B) .
- L’exception des contrats conclus entre personnes privées
Le conseil d’Etat, dans son arrêt de section du 13 décembre 1963 aussi appelé « syndicat des praticiens de l’art dentaire du département du Nord », a affirmé que les contrats conclus entre personnes privées relèvent à priori du droit privé. Cette décision a été confirmé par le tribunal des conflits dans sa décision « société Interlait » du 3 mars 1969 . Néanmoins, il existe plusieurs exceptions à ce principe. En effet, il a déjà été dit que selon l’arrêt « Prades » du conseil d’Etat, en date du 18 décembre 1936, la personne publique partie au contrat peut être représentée par une personne privée par le biais d’un mandat, y compris lorsque celui-ci est tacite.
De plus, dans sa décision du 8 juillet 1963, « société entreprise Peyrot », le tribunal des conflits a déterminé que le contrat conclu entre deux personnes privées était administratif si l’objet du contrat appartenait à l’Etat par sa nature, les cocontractants agissant indirectement pour l’Etat qui est une personne morale de droit public. Cependant, le tribunal des conflits a atténué ce principe dans sa décision « société ASF » du 9 mars 2015 , en affirmant qu’une personne privée ne peut agir pour le compte de l’Etat, excepté si des clauses du contrat le précise. Mais cette décision n’est applicable qu’aux contrats conclus à partir du 9 mars 2015.
Ainsi, la distinction entre contrat administratif et contrat privé est parfois floue. C’est pour cette raison qu’il existe un autre critère de distinction, appelé critère alternatif ou critère matériel (II) .
- La précision de la distinction avec le critère matériel
Le critère matériel est aussi appelé critère alternatif parce qu’il se divise en deux branches. En effet, pour le contrat soit administratif il peut soit relever d’un régime exorbitant du droit commun (A) , soit avoir un lien avec l’exécution du service public (B) .
- La particularité du régime exorbitant du droit commun
Pour que le contrat relève d’un régime exorbitant il faut une ou plusieurs clauses exorbitantes. A l’origine, le Conseil d’Etat a défini la clause exorbitante comme la clause inhabituelle, voire illégale, en droit privé car elle crée des obligations que l’on ne trouve jamais en droit privé, dans son arrêt du 31 juillet 1912 « société des granits porphyroïde des Vosges » . Mais le Tribunal des Conflits a fait évoluer cette définition. En effet, dans sa décision « AXA France Yard », datant de 2014 , il redéfinit la clause exorbitante comme celle qui propose des avantages exorbitants du droit au commun, justifié par les besoins de l’intérêt général.
Ainsi, le prérogative de puissance publique permet aux parties du contrat d’avoir des pouvoirs exorbitants. Il existe des cas ou le contrat n’a aucune clause exorbitante, mais le juge détermine que le contrat en lui-même est exorbitant, et donc administratif. C’est le principe posé par le conseil d’Etat dans sa décision « société d’exploitation électrique de la rivière du Sant » du 19 janvier 1973. De plus, un service public industriel et commercial est un service public soumis principalement aux règles de droit privé et à l’ordre juridique juridictionnel. Ainsi, dans l’arrêt de 1962 « dame Bertrand » du Tribunal des Conflits affirme que tout contrat conclu entre un service public industriel et commercial et ses agents ou usagers est un contrat privé.
La deuxième branche du critère alternatif, qui permet de distinguer un contrat administratif d’un contrat de droit privé, est le lien de ce contrat avec le service public (B) .
- L’exigence d’un lien avec le service public
Si le contrat a pour objet de faire fonctionner le service public, alors il s’agira d’un contrat administratif puisque c’est la prérogative de puissance publique. Ainsi, dans sa décision « époux Bertin » du 20 avril 1946, le conseil d’Etat affirme le critère constant selon lequel tout contrat dont les cocontractants participe directement à l’exécution d’un service public est un contrat administratif.
De plus, d’après la décision du conseil d’Etat du 20 avril 1956, « consorts Grimouard », si le contrat lui-même a pour objet l’exécution d’un service public, que c’est sa conclusion qui fait fonctionner le service public, alors il s’agit également d’un contrat administratif. Enfin, tout contrat conclu entre un agent et l’administration qui l’emploi est un contrat administratif, ce principe étant affirmé par le Tribunal des Conflits dans sa décision du 25 mars 1996, aussi appelée l’arrêt « Berkani » . Ainsi, lorsqu’un contrat a un lien étroit ou plus indirect avec le service public, il sera administratif.
C’est tout pour cette dissertation juridique de droit administratif intégralement rédigée et corrigée sur le sujet du contrat administratif et ses critères d’identification.
Poster le commentaire Annuler la réponse
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *
Commentaire *
Enregistrer mon nom, mon e-mail et mon site dans le navigateur pour mon prochain commentaire.
Recent Posts
- Quelles sont les prestations généralement proposées par un cabinet d’avocats ?
- Lutte contre l’artificialisation des sols : un levier majeur pour réduire les émissions de gaz à effets de serre
- Comprendre la classification tripartite des infractions : crimes, délits et contraventions
- Comprendre la jurisprudence et la doctrine
- Le régime de responsabilité civile du fait des animaux : Article 1243 du Code Civil
Recent Comments
Évitez les fautes dans vos écrits académiques
Évitez le plagiat gratuitement, faire une bibliographie gratuitement.
- Dissertation
Exemple de dissertation juridique
Publié le 26 novembre 2018 par Justine Debret . Mis à jour le 7 décembre 2020.
Il est important de savoir ce que vos évaluateurs attendent de vous pour une dissertation juridique. Voici des exemples complets de dissertations juridiques que vous pouvez consulter et télécharger pour comprendre ce qui est attendu.
Inspirez-vous, sans plagier ! Ces exemples sont là pour vous aider, mais ne faites pas de copier-coller. Il est important de ne pas commettre de plagiat .
Une dissertation sans erreur Relisez et corrigez les fautes avant de rendre votre dissertation juridique. Votre évaluateur risque de vous pénaliser pour une orthographe et un style peu soignés.
Table des matières
Exemple 1 de dissertation juridique, exemple 2 de dissertation juridique, exemple 3 de dissertation juridique, exemple 4 de dissertation juridique, exemple 5 de dissertation juridique, exemple 6 de dissertation juridique, exemple 7 de dissertation juridique, exemple 8 de dissertation juridique, exemple 9 de dissertation juridique.
Sujet : « La spécificité du droit administratif. »
Cet exemple de dissertation juridique porte sur le droit administratif et a été problématisée autour de la question « en quoi le droit administratif, domaine du droit public, se distingue-t-il de manière originale des autres catégories de droit ? ».
Télécharger l’exemple de dissertation
Corriger des textes rapidement et facilement
Corrigez des phrases, des paragraphes ou des textes entiers en un clin d'œil grâce à notre correcteur d'orthographe gratuit.
Corriger un texte gratuitement
Sujet : « Le Conseil d’État est-il un juge impartial de l’administration ? »
Il s’agit d’une dissertation de droit en droit administratif. Elle porte sur le Conseil d’État et sur la question de son impartialité réelle envers l’administration.
Sujet : « Qui détient la fonction législative dans l’UE ? »
Cette dissertation de droit européen questionne la fonction législative au sein de l’Union européenne. La problématique de cette dissertation est : « quelles sont les différentes entités européennes qui prennent part à la fonction législative au sein de l’UE ? ».
Sujet : « La responsabilité de l’État dans la déportation. »
Il s’agit d’une dissertation de droit administratif porte sur la responsabilité de l’État. Elle tente de répondre à la problématique « en quoi est-il possible de reconnaître à l’Etat français une responsabilité dans le rôle qu’il a joué lors de la déportation des juifs sous le régime de Vichy pendant la Second Guerre mondiale ? ».
Corriger des textes efficacement et rapidement
Sujet : « Quels changements le Traité de Lisbonne a-t-il apporté à l’organisation de la structure de l’UE ? »
Cette dissertation de droit européen porte sur le Traité de Lisbonne et plus spécifiquement sur les innovations institutionnelles qu’il a instaure pour adapter l’Union aux nécessités évolutives du contexte de l’époque.
Sujet : « En quoi les Conseils sont-ils les institutions inter-étatiques de l’UE ? »
Il s’agit d’une dissertation de droit européen sur le rôle et la nature des conseils de l’UE : le Conseil des ministres et le Conseil Européen.
Sujet : « Comment l’UE envisage-t-elle le principe de subsidiarité ? »
Cette dissertation de droit européen porte sur le principe de subsidiarité. La problématique est « de quelle manière l’UE aborde-t-elle le principe de subsidiarité dans le droit européen, mais aussi dans le fonctionnement de l’UE ? ».
Sujet : « L’évolution du rôle du Parlement européen. »
Cette dissertation de droit européen relate l’évolution historique du Parlement européen lors de la construction européenne et ses évolutions fonctionnelles.
Sujet : « La Commission, garante de l’intérêt général de l’UE. »
Il s’agit d’une dissertation de droit européen sur le rôle de la Commission européenne comme garante de l’inerte général européen.
Citer cet article de Scribbr
Si vous souhaitez citer cette source, vous pouvez la copier/coller ou cliquer sur le bouton “Citez cet article” pour l’ajouter automatiquement à notre Générateur de sources gratuit.
Debret, J. (2020, 07 décembre). Exemple de dissertation juridique. Scribbr. Consulté le 26 mai 2024, de https://www.scribbr.fr/dissertation-fr/exemple-dissertation-juridique/
Cet article est-il utile ?
Justine Debret
D'autres étudiants ont aussi consulté..., le plan d’une dissertation juridique, introduction de dissertation de droit.

- THÈMES JURIDIQUES
- Méthodologies
- Commande & correction de doc
- LE BLOG JURIDIQUE
- Actualités en droit
- Conseils juridiques
Consultez tous nos documents en illimité !
à partir de 9.95 € sans engagement de durée
Exemples de sujets de dissertation sur le juge administratif
Dans l'ordre juridique français, le juge administratif tient une place de choix. Distingué des autres magistrats (notamment de l'ordre judiciaire), le juge administratif est une singularité historique et politique du droit français qui s'est largement construit autour de grandes décisions jurisprudentielles et des normes héritées de la tumultueuse histoire de l'administration française. Ces dix sujets explorent un panel plus ou moins large de l'amplitude des questions que peut recouvrir la notion de juge administratif.

Credit Photo : Freepik stories

Sujet 1 – Le juge administratif et la responsabilité administrative
La responsabilité administrative est une notion qui s’est durablement implantée dans le droit administratif français. Le juge administratif a la possibilité d’effectuer un contrôle de cette dernière (de l’identification à la qualification nominale), notamment lorsque survient un contentieux.
Source : Université numérique juridique francophone, « droit de la responsabilité administrative »
Sujet 2 – Pourquoi recourir au juge administratif ?
Recourir au juge administratif n’est pas anodin. La reformulation de ce sujet peut conduire à identifier à la fois les pouvoirs du juge administratif, mais également les motivations qui peuvent pousser le justiciable à recourir à ce dernier.
Source : Vie-Publique.fr : « Quels sont les pouvoirs du juge administratif ? »
Sujet 3 – La naissance du juge administratif
Ce sujet, à vocation davantage historique, invite à se plonger dans une section de l’histoire du droit : l’histoire du droit administratif. Le juge administratif n’est pas un juge comme les autres. Dépositaire de l’autorité de l’État, il se distingue des autres magistrats par sa filiation et ses attributions.
Source : Vie-Publique.fr : « Pourquoi une justice administrative ? »
Sujet 4 – Le juge administratif et le contrat administratif
Le contrat administratif est soumis au contrôle de régularité et, éventuellement, du contentieux qui peut en émerger, du juge administratif. Quels sont les faisceaux d’indices qui peuvent évoquer le juge administratif dans le contrôle du contrat administratif, par exemple ?
Source : Vie-Publique.fr : « En quoi consistent les contrats administratifs ? »
Sujet 5 – Le juge administratif et le recours en excès de pouvoir (REP)
Le recours en excès de pouvoir (REP) est une action importante de l’ordre juridique français. Il doit être distingué du recours de plein contentieux (RPC) et doit être défini dans son rapport au juge administratif : comment le juge administratif peut-il apprécier l’annulation d’un acte administratif ?
Source : Revue générale du droit : « Conditions de recevabilité du recours pour excès de pouvoir »
Sujet 6 – Le juge administratif et la constitutionnalité des lois
Le contrôle de constitutionnalité des lois n’est pas confié au juge administratif, mais au Conseil constitutionnel. Mais pourquoi s’est manifesté ce refus du juge administratif de contrôler la constitutionnalité des lois ? Comment comprendre l’ arrêt Nicolo du Conseil d’État de 1989 ?
Source : Conseil d’État, Assemblée, 20 octobre 1989, Nicolo sur le site Internet du Conseil d’État
Sujet 7 – Le juge administratif et le droit international
Pour comprendre les liens qui peuvent unir le juge administratif français et le droit international, il est bon de se plonger dans un arrêt du Conseil d’État, l’ arrêt GISTI de 1990. L’attribution progressive de la possibilité d’une interprétation des conventions et des accords internationaux au détriment d’un renvoi à la puissance publique (en l’occurrence, le ministre des Affaires étrangères) est un tournant dans l’histoire du droit administratif.
Source : L. Dubouis, 1971 : « Le juge administratif français et les règles du droit international »
Sujet 8 – Le contrôle de l’excès de pouvoir par le juge administratif
Le contrôle de la puissance publique et de ses prérogatives requiert un examen de la notion du contrôle de l’excès de pouvoir : le juge administratif a progressivement acté la responsabilité de l’État et, surtout, la possibilité pour le justiciable de se prévaloir d’un intérêt à agir face à la puissance publique.
Source : Conseil constitutionnel : « Excès de pouvoir administratif et excès de pouvoir législatif »
Sujet 9 – Le juge administratif et le pouvoir du chef de service
Le pouvoir réglementaire du chef de service est l’objet d’un célèbre arrêt du juge administratif, l’ arrêt Jamart de 1936 du Conseil d’État. Alors que le chef de service a les coudées franches pour organiser son service ainsi qu’il l’entend et, surtout, dans l’intérêt de ce dernier, il est néanmoins borné par les lois en vigueur et l’ordre constitutionnel français, de même que les principes généraux du droit (PGD).
Source : actu.dalloz-étudiant.fr : « Pouvoir réglementaire des ministres »
Sujet 10 – Le juge administratif et les principes généraux du droit (PGD)
Les principes généraux du droit (PGD) sont généralement « découverts » par le juge administratif : la jurisprudence administrative a ainsi pu dégager plusieurs PGD, à l’instar de la proclamation de l’égalité des usagers du service public français (Société des concerts du conservatoire du Conseil d’État, 1951). Source : Carrieres-publiques.com : « Les principes généraux du droit »
Besoin d'un tuteur ? Nous pouvons vous aider !
Articles liés.

Les règles d'intégrité, transparence et de responsabilité...

Télétravail et fin de contrat de travail : la question de...

Les institutions internationales : OIG et ONG
Articles récents

Le rôle du Parlement européen dans la procédure...

Le fonctionnement du Parlement européen
EXCEPTIONNEL ! -30% à partir de 3 outils jusqu'au 31/5

- 8 min de lecture
[DISSERTATION] Le pouvoir discrétionnaire de l’administration (Droit administratif)
Cours et copies > Droit Administratif
Cette dissertation traite du pouvoir discrétionnaire de l’administration en droit administratif. Découvrez cette copie de droit administratif sur la thématique du contrôle juridictionnel de l’exercice du pouvoir discrétionnaire de l’administration (note : 14/20). 🔥
✊ I- La notion de pouvoir discrétionnaire
😕 A- La distinction entre le pouvoir discrétionnaire et le pouvoir arbitraire
🤨 B- La combinaison entre le pouvoir discrétionnaire et la compétence liée
👮♂️ II- La mise en place progressive d’un contrôle juridictionnel du pouvoir discrétionnaire de l’administration
🖐 A- L’absence traditionnelle de contrôle
👌 B- Le développement d’un contrôle du pouvoir discrétionnaire

N.B.: Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait.
Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊
Sujet théorique : le contrôle juridictionnel de l’exercice du pouvoir discrétionnaire de l’administration
« C’est du degré du contrôle exercé par le juge que dépend en dernière analyse la marge de pouvoir discrétionnaire laissée à l’administration » (Danièle Lochak). En effet, le pouvoir discrétionnaire de l’administration constitue un contrepoids général au principe de légalité. Mais plus ce pouvoir est contrôlé, plus la marge de manœuvre de l’administration diminue.
Commentaire de l’enseignant :
"Poser le sujet après la phrase d’attaque."
En réalité, le pouvoir discrétionnaire est défini comme étant l’un des pouvoirs qui accorde à l’administration la plus grande liberté qui lui est reconnue d’apprécier l’opportunité de la mesure à prendre et la détermination de son contenu. Autrement dit, le pouvoir discrétionnaire offre à l’administration la liberté de prendre la décision de son choix car la règle de droit ne lui dicte pas d’agir dans un sens ou dans un autre. Elle se réserve donc une certaine liberté. Cependant, cette notion se combine également avec ce que l’on appelle la compétence liée, puisque les deux notions sont liées en permanence.
Au regard de la grande liberté accordée à l’administration à travers ce pouvoir discrétionnaire, il est évident qu’un certain contrôle est nécessaire à son exercice. Durant longtemps, on estimait qu’il ne pouvait pas y avoir de contrôle. Or, aujourd’hui, un véritable contrôle de l’exercice du pouvoir discrétionnaire s’est développé, a évolué au fil du temps et aboutit donc à une réduction de ce pouvoir.
Il est alors intéressant de s’interroger de la façon suivante : comment a évolué le contrôle juridictionnel de l’exercice du pouvoir discrétionnaire de l’administration au fil du temps ?
"Intérêt du sujet."
Si la notion de pouvoir discrétionnaire (I) est une notion très importante qu’il est essentiel de distinguer d’autres pouvoirs, celle-ci nécessite la mise en place d’un contrôle du pouvoir discrétionnaire (II) qui s’est opéré au fil du temps.
I) La notion de pouvoir discrétionnaire
"mettre à l’introduction"
Si le pouvoir discrétionnaire accorde à l’administration une grande liberté, celui ne doit néanmoins pas se confondre avec un pouvoir arbitraire (A). De plus, afin de définir la notion de pouvoir discrétionnaire il faut également préciser la combinaison permanente de ce pouvoir avec la compétence liée (B).
A) La distinction entre le pouvoir discrétionnaire et le pouvoir arbitraire
Classiquement, on admet qu’en situation de pouvoir discrétionnaire, l’administration est libre de prendre la décision de son choix, la règle de droit ne lui dicte pas sa conduite à l’avance. Dans cette situation, le rapport entre les circonstances de fait et le contenu de la mesure est indéterminé. Cependant, le pouvoir discrétionnaire de l’administration ne se confond pas à un pouvoir arbitraire. En effet, investie d’un pouvoir discrétionnaire, l’administration ne peut choisir qu’entre des décisions ou des comportements qui sont conformes à la légalité.
Pour donner un exemple de pouvoir discrétionnaire, on peut se référer à l’article 1 e de la loi de 1955 relative à l’état d’urgence qui accorde au chef de l’Etat le pouvoir discrétionnaire puisqu’il peut déclarer l’état d’urgence sur tout ou partie du territoire mais selon certaines conditions, c’est-à-dire soit en cas de péril résultant d’une atteinte grave à l’ordre public, soit en cas d’évènement présentant le caractère de calamité publique. Ainsi, le pouvoir discrétionnaire accordé à l’administration ne constitue pas un pouvoir arbitraire, celui-ci est soumis à la conformité de la légalité.
B) La combinaison entre le pouvoir discrétionnaire et la compétence liée
La compétence liée se définit par le sens selon lequel en présence de telle ou telle circonstance de fait, l’autorité administrative est tenue de prendre telle décision parce que la règle de droit lui dicte sa conduite à l’avance. Les agents sont donc tenus d’agir dans un sens déterminé. Le rapport entre la circonstance de fait et le contenu de la mesure est donc déterminé par la règle de droit. Pour illustrer ce principe, on peut se référer à l’exemple de la délivrance de l’agrément des exploitants et dirigeants de société de sécurité privée. Cette délivrance est subordonnée à certaines conditions relevant de l’article L. 612-7 du Code de la sécurité intérieure. Si ces conditions sont remplies, l’agrément doit être délivré. Ainsi, l’autorité qui délivre l’agrément se trouve dans une situation de compétence liée.
De ce fait, il est donc important de préciser que cette notion de compétence liée se lie à la notion de pouvoir discrétionnaire en permanence. En effet, les deux notions se combinent, une dose variable de pouvoir discrétionnaire et de compétence liée est présente dans chaque acte administratif [Ndlr : Voir un commentaire d'arrêt sur les actes administratifs ]. D’une part, les attributions de chaque agent sont déterminées par une règle de droit, la compétence n’est donc pas discrétionnaire. D’autre part, le but de l’acte en question doit toujours être un but d’intérêt public. Parfois, il est également possible que la forme et la procédure préalable à l’édiction de l’acte ne soient pas discrétionnaires mais indiquées par la règle de droit. Les actes administratifs ne sont donc pas toujours totalement discrétionnaires, et c’est de cette façon que les deux notions de pouvoir discrétionnaire et de compétence liée se combinent.
Le pouvoir discrétionnaire de l’administration, bien que celui-ci ne soit pas toujours totalement discrétionnaire et se combine à la compétence liée, accorde néanmoins une grande liberté à l’administration. De cette façon, il est impératif que ce pouvoir doté d’une telle liberté soit contrôlé.
❤️ Recommandé pour vous :
La solution pour mémoriser enfin les arrêts de la jurisprudence administrative
Tout savoir sur le Droit Administratif
II) La mise en place progressive d’un contrôle juridictionnel du pouvoir discrétionnaire de l’administration
Il a fallu une considérable évolution de la jurisprudence pour qu’un contrôle du pouvoir discrétionnaire se développe (B) car autrefois, on estimait que ce contrôle ne pouvait pas être possible (A).
A) L’absence traditionnelle de contrôle
Traditionnellement, on constatait une absence de contrôle du pouvoir discrétionnaire de l’administration. Cette absence était justifiée par le fait que le juge administratif est exclusivement le juge de la légalité des décisions administratives et non de leur opportunité. Donc, en raison du principe de la séparation de l’administration et de son juge établi par un arrêt du Conseil d’Etat intitulé « Cadot » datant du 13 décembre 1889 , le juge administratif s’est refusé de contrôler la qualification juridique des faits. Lorsque l’administration se trouve dans une situation de pouvoir discrétionnaire, l’acte ne peut être jugé du point de vue de la légalité puisque la règle de droit n’indique pas dans quel sens l’administration doit agir, et ceci est un jugement que le juge se refuse de porter.
Cependant, on peut considérer que le juge a toujours exercé un contrôle certes très restreint. Par exemple, le juge a toujours contrôlé la compétence de l’auteur de l’acte, le vice de forme et de procédure, le détournement de pouvoir, la violation directe de la loi, l’erreur de droit ou encore l’exactitude matérielle des faits. Le juge peut ensuite arrêter son contrôle. Dans certains cas rares, c’est ce que celui-ci continue de faire. Par exemple, le Conseil d’Etat refuse de contrôler l’appréciation faite par le jury d’un examen de la valeur des copies remises par les candidats selon un arrêt du Conseil d’Etat intitulé « Gambus » datant du 20 mars 1987. Avec le temps, la jurisprudence a évolué et un véritable contrôle s’est mis en place.
❤️ Recommandé pour vous : [DISSERTATION] Les fonctions du Conseil d'État (Droit administratif)
B) Le développement d’un contrôle du pouvoir discrétionnaire
Aujourd’hui, le juge administratif exerce normalement un contrôle de la qualification juridique des faits. Dans certains contentieux, le contrôle du juge est particulièrement étendu puisque celui-ci vérifie la proportionnalité de la mesure prise par l’administration au regard des circonstances de l’affaire.
Un véritable contrôle du pouvoir discrétionnaire de l’administration s’est mis en place. On peut notamment distinguer trois degrés de contrôle. Tout d’abord, il existe le contrôle minimum, celui-ci ne porte pas sur la qualification juridique des faits. Cependant, dans un arrêt « Lagrange » de 1961, le Conseil d’Etat admet qu’une erreur manifeste commise par l’administration dans les appréciations de faits auxquelles elle s’est livrée peut constituer un excès de pouvoir [Ndlr : Voir un commentaire d'arrêt sur le recours pour excès de pouvoir ]. Par ailleurs, ce contrôle s’est notamment développé dans le domaine des publications étrangères avec l’arrêt SA Librairie François Maspero du Conseil d’Etat en 1973. Secondement, il existe le contrôle normal, celui-ci porte sur la qualification juridique des faits. Le juge vérifie donc si les faits tels qu’ils existent présentent les caractéristiques permettant de prendre la décision. Enfin, il existe le contrôle maximum qui est davantage poussé. La marge de manœuvre de l’administration est donc réduite. Dans certains contentieux, le contrôle de la qualification juridique s’exerce à la fois sur le motif, sur le dispositif et sur la relation qui doit exister entre les deux.
Concernant le contentieux des pouvoirs de police administrative [Ndlr : Voir un commentaire d'arrêt sur la police administrative ], dans un arrêt Benjamin rendu en 1933, le Conseil d’Etat synthétise la teneur du contrôle de proportionnalité. A travers cet arrêt, il reconnait que l’arrêté d’interdiction du maire de Nevers n’était pas nécessaire et que d’autres mesures policières plus appropriées auraient pu être adoptées au regard des troubles à l’ordre public susceptibles d’être occasionnés par la conférence du Sieur Benjamin. Concernant le contentieux des opérations d’expropriations, le juge administratif apprécie l’utilité publique de l’opération d’expropriation envisagée en mettant en balance les avantages et les inconvénients selon un arrêt Ville Nouvelle Est du Conseil d’Etat datant de 1971. Il existe donc aujourd’hui un véritable contrôle du pouvoir discrétionnaire du juge administratif qui s’est développé au fils du temps grâce à la jurisprudence, ce qui réduit donc sa liberté. La marge de manœuvre et de liberté accordée à l’administration diminue donc en fonction de l’intensité du contrôle effectué.
Kahena Lambing
🧰 Parce que votre réussite nous tient à cœur, augmentez vos chances de valider votre année en découvrant toutes les ressources de la BOÎTE À OUTILS (Flashcards Pamplemousse, Fiches de révisions, Livres de réussite).
💖 Recevez aussi des good vibes, des conseils confidentiels et réductions exclusives en recevant la NEWSLETTER DU BONHEUR .
Dissertation juridique : les 10 conseils d'un chargé de TD
Comment réussir sa dissertation juridique ?
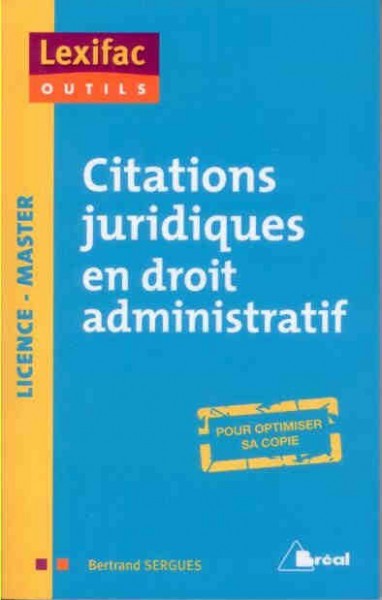
Parution : 01/2019 Editeur : Bréal ISBN : 978-2-7495-3842-6
Citations juridiques en droit administratif
Licence-master, pour optimiser sa copie, présentation de l'éditeur.
Vous avez besoin d'une citation juridique pour la phrase d'accroche de votre devoir ? Vous éprouvez des difficultés à trouver une citation en lien avec le sujet qu'il vous est demandé de traiter ?
Ce livre référence plus de 800 citations qui vous seront d'une aide très précieuse dans la rédaction de vos copies.
Connaître les grandes citations de la matière administrative sera pour vous l'assurance d'aborder sereinement vos examens universitaires.
Cet ouvrage s'adresse aux étudiants inscrits en :
- Licence de droit, d'AES, de sciences politiques et d'IEP ; - centres de préparation à l'administration générale, aux concours de la fonction publique ; - Master 1 et 2 de droit public ; - Doctorat de droit public, de sciences politiques ou d'AES.
> Un recueil indispensable pour réussir.
Le corps enseignant vous demande d'introduire vos copies de dissertation et de commentaire de texte par une citation d'accroche.
> Un ouvrage pratique et facile à utiliser.
Plus de 800 citations sont classées en 61 thématiques qui correspondent à la totalité des grandes notions développées en cours de droit administratif.
> Des sources fiables.
Les sources de ces citations ont fait l'objet de nombreuses recherches pour garantir leur fiabilité. Elles sont référencées selon les « canons » imposés par l'université pour la rédaction des publications scientifiques.
Bertrand Sergues est enseignant universitaire. Au sein de l'Université Toulouse 1 Capitole, il enseigne le droit constitutionnel, le droit administratif ainsi que la matière "culture générale et juridique"
Lexifac - Outils , 174 pages. 13,00 €
Le rapporteur public devant les juridictions administratives
Cet ouvrage retrace les réflexions partagées entre universitaires et praticiens du droit lors d’un colloque qui s’est tenu le 6 octobre 2023 sur le rapporteur public devant les juridictions administratives.
Cette manifestation a été l’occasion de dresser un bilan de la décision du Conseil d’État Section du 21 juin 2013 Communauté d’agglomération...
Avec Cormenin
Figure essentielle de la doctrine juridique du XIXe siècle, considéré traditionnellement, aux coté de Gérando et Macarel, comme membre d'une célèbre triade fondatrice du droit administratif, à tout le moins comme l'un de ses glorieux « ancêtre », Louis de Cormenin est assurément un acteur incontournable de l'histoire du droit et du droit positif contemporains....
Le rescrit est un procédé employé pour obtenir de l’administration une réponse sur l’application du droit à une situation particulière avec possibilité de s’en prévaloir ultérieurement, même si le contenu de cette réponse est illégal. En cela, le rescrit suscite de la méfiance. Il porterait atteinte aux principes fondamentaux du droit public : légalité,...
Le Conseil constitutionnel et la commande publique
La commande publique apparaît comme une notion propre au droit administratif. Longtemps encadré par des textes à valeur réglementaire, le rôle du juge de la constitutionnalité semble très restreint. Pourtant, que serait devenue la commande publique sans le Conseil constitutionnel ?
C’est en effet grâce aux juges de la rue de Montpensier que la notion...
L’excès de pouvoir négatif de l’administration
La dichotomie entre excès de pouvoir positif et excès de pouvoir négatif est majoritairement étrangère à l’étude de l’excès de pouvoir administratif. En effet, contrairement à son pendant judiciaire, il n’est jamais présenté comme un concept susceptible de se dédoubler en fonction de la nature positive ou négative de l’illégalité commise. Cet...
Les biens publics à l'étranger
Il n'y a encore aucune étude consacrée au sujet des biens publics à l'étranger.
Pourtant, les enjeux théoriques et pratiques sont considérables, ils sont de nature à orienter toute une politique publique qui se révèle progressivement avec des contentieux qui sont apparus récemment.
Pour la première fois, cette recherche associe des administrativistes...
L'ordre public contractuel en droit administratif
Alors que l’ordre public contractuel a fait l’objet d’innombrables investigations en droit privé, il n’existait en droit administratif aucune recherche doctorale dédiée à ce thème majeur du droit des contrats. La thèse se propose de combler cette lacune en répondant finalement à deux questions : comment savoir qu’une règle quelconque est d’ordre...
Les réitérations de norme
Le droit est constitué d’un certain nombre de contenus qui ne semblent être rien d’autre que la « réitération » d’une norme préexistante.
Le juge administratif se fonde sur le caractère réitératif d’un acte pour apprécier la recevabilité du recours mais aussi dans le cadre de l’exercice de son contrôle au fond. Toutefois, les modalités...
L’acte administratif transnational
L’acte administratif transnational est un acte unilatéral qui produit directement un effet de droit contraignant dans l’ordre juridique d’un ou de plusieurs États de réception.
Le constat de l’existence et du développement croissant de ce type d’acte vient interroger la transformation de l’action administrative face à la mondialisation et à...
Petit lexique de droit funéraire
Un corbillard peut-il être rose ? Que devient la prothèse du défunt après sa crémation ? Le propriétaire d'un animal domestique peut-il le faire inhumer avec lui après sa mort ? Les membres de la famille d'un défunt ont-ils l'obligation d'entretenir sa sépulture ? Peut-on inhumer un cadavre sur un terrain privé ? Un maire peut-il s'opposer à l'inhumation...
L’après-contrat administratif
L’étude de l’après-contrat est celle d’un paradoxe, celle d’un contrat qui a pris fin mais dont les effets continuent de s’observer. Jusqu’à présent centrée sur la fin du contrat et ses conséquences, la doctrine publiciste n’avait pas envisagé la période postérieure au contrat. C’est à cette lacune que se propose de répondre l’étude.
L’après-contrat...
Les enfermements administratifs et l’Habeas corpus
Le présent ouvrage porte sur les enfermements décidés par des autorités administratives en dehors de toutes poursuites pénales. Les situations dans lesquelles un tel enfermement peut être décidé ont toujours existé, dans tous les systèmes juridiques. Ce qui permet de distinguer l’État libéral de l’État autoritaire, c’est la protection de l’individu...
- Manifestations scientifiques
- Appels en cours
- Actualités des formations
- Concours, qualifications, recrutements
- Postes d'enseignants-chercheurs
- Postes d'ATER
- Emplois contractuels
- Actualités des facultés de droit
- Flux RSS & Canaux d'information
- Toutes les licences
- Doubles licences
- Licences internationales
- Parcours d’excellence
- Trouver un master
- Préparations aux concours
- Capacité en droit
- Se former à distance
- Licences professionnelles
- Diplômes d'université
- Formations courtes
- Facultés de droit
- Instituts d’études judiciaires
- Instituts du travail
- Cliniques juridiques
- Le droit en terminale
- Les métiers du droit
- Enseignants-chercheurs
- Docteurs en droit
- Les éditeurs juridiques
- Droit privé
- Droit public
- Histoire du droit
- Science politique
- Thèmes de recherche
- Laboratoires
- Ecoles doctorales
- Sociétés savantes
- Revues en libre accès
- Présentation
- Mettre en place une FOAD avec les cours UNJF
- Cours en accès libre
- Accéder à la plateforme de cours
- Liste des cours en ligne
- Préparation du CRFPA
- Liste des facultés
- Actualités des facultés
- La Conférence des doyens
- Conseil national des universités
- La Conférence nationale du droit
- L'Association des directeurs d'IEJ
- La Conférence des directeurs d'IPAG
- Présentation du portail
- La fondation Ius & Politia
- Les projets en cours
- Communication

IMAGES
VIDEO
COMMENTS
De plus, la phrase d'accroche permet de dégager l'esprit de la copie ainsi que sa qualité, donc tout se joue dès l'introduction. Voici quelques exemples de phrase d'accroche utile en droit administratif classés selon les sujets abordés le plus souvent durant les dissertations.
En droit, que ce soit pour une dissertation, un commentaire d'arrêt ou de texte, une belle phrase d'accroche vous permet d'introduire de manière percutante votre sujet. Dans cet article, nous vous proposons différentes méthodes pour trouver une bonne phrase d'accroche ainsi que quelques exemples que vous pourrez utiliser dans vos copies de droit.
Exemple de dissertation en droit administratif. [Cliquez ici pour télécharger 20 fiches de révisions pour réviser efficacement le droit administratif !] Vous trouverez ci-dessous un exemple de dissertation en droit administratif. Cette dissertation a été réalisée par une étudiante en L2 Droit à l'Université de Nanterre.
Votre PROGRAMME de droit administratif L2 traité à travers les. DIFFÉRENTES ÉPREUVES. rencontrées en TD et lors de l'EXAMEN FINAL (dissertation, commentaire d'arrêt, cas pratique et QCM). Les CORRIGÉS sont CONFORMES. aux attentes de votre professeur et à ce que vous pouvez réaliser dans le temps imparti.
1. L'accroche dans une introduction de dissertation de droit. La phrase d'accroche permet d'entrer dans le vif du sujet de la dissertation de droit, d'attirer l'intérêt du lecteur et d'engager votre réflexion personnelle. Elle peut être une situation historique, une citation (dont vous connaissez l'auteur) ou un fait d ...
A la recherche d'une phrase d'accroche pour une dissertation juridique, un commentaire de texte ou un commentaire d'arrêt ? Découvrez 100 citations juridiques prêtes à l'emploi dans plus de 8 matières (droit constitutionnel, introduction au droit, droit des biens, droit de la famille, droit de la responsabilité civile, droit administratif, droit pénal, la justice).
Le droit administratif se définit comme l'ensemble des règles applicables aux activités de l'administration. Étant un droit autonome, celui-ci est marqué par le rôle fondateur et indispensable du juge administratif qui, par sa jurisprudence, dégage des principes fondateurs et dispose d'un pouvoir d'interprétation conséquent.
1er ingrédient : les connaissances. La dissertation juridique est un exercice qui nécessite la mobilisation de nombreuses connaissances acquises grâce aux cours, TD et lectures personnelles (ouvrages, articles de doctrine, etc.). Maîtriser parfaitement ce qui a été vu en cours et en TD est donc indispensable pour réaliser une bonne ...
Il est conseillé de rédiger l'introduction de votre dissertation de droit entièrement au brouillon et elle doit faire au moins une page. 1. La phrase d'accroche. La phrase d'accroche permet d'entrer dans le vif du sujet de la dissertation de droit, d'attirer l'intérêt du lecteur et d'engager votre réflexion personnelle.
Voici un exemple de dissertation en droit administratif sur les principes généraux du droit et le pouvoir créateur du juge (19/20). top of page. ... [Accroche] Louis Dubouis a dit « il ne saurait y avoir en droit de théorie plus fabuleuse que celle des principes, le juriste s'en convainc pour peu qu'il prête attention aux plus nobles ...
Une phrase d'accroche est une phrase ou un paragraphe qui introduit votre sujet dans l'introduction et doit attirer l'attention de votre lecteur. Cette phrase est le fruit d'un choix personnel et vous être libre de choisir son style. C'est également le tout premier moment de votre dissertation.
La dissertation aborde l'identification du contrat administratif par ses différents critères (organique, matériel). Cette copie a obtenu la note de 17/20. N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d'un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée.
PDF Droit administratif L2. Droit Administratif. Notes de cours. 100% (5) 3. Méthode pour le commentaire d'arrêt L2. Droit Administratif. ... Dissertation L'application de l'article 55 de la Constitution par le juge administratif; Dissertation Le dualisme juridictionnel peut-il être remit en cause; Méthode pour le commentaire d'arrêt ...
Cette dissertation juridique corrigée porte sur un chapitre essentiel du cours de droit administratif : les critères d'identification du contrat administratif. Ce devoir réalisé par Louna a reçu la note de 12.5/20 !. Sujet : les critères du contrat administratif « Le contrat administratif suppose essentiellement deux contractants, qui se reconnaissent placés sur un pied d ...
Exemple 5 de dissertation juridique. Sujet : « Quels changements le Traité de Lisbonne a-t-il apporté à l'organisation de la structure de l'UE ?. Cette dissertation de droit européen porte sur le Traité de Lisbonne et plus spécifiquement sur les innovations institutionnelles qu'il a instaure pour adapter l'Union aux nécessités évolutives du contexte de l'époque.
Sujet 3 - La naissance du juge administratif. Ce sujet, à vocation davantage historique, invite à se plonger dans une section de l'histoire du droit : l'histoire du droit administratif. Le juge administratif n'est pas un juge comme les autres. Dépositaire de l'autorité de l'État, il se distingue des autres magistrats par sa ...
Dissertation : « Le caractère subjectif du contrôle de la police administrative » « En l'état de droit, la moralité publique est une composante de la notion d'ordre public », Chapus. Selon le professeur Chapus la moralité publique est la quatrième composante de la notion d'ordre public.
Dissertation sur la responsabilité administrative léana groupe droit administratif sujet quelles évolutions pour la responsabilité administrative selon le. Passer au document. ... Dissertation Droit Administrative Séance 9. Matière: Droit Administratif 2. 44 Documents.
Cette dissertation traite du pouvoir discrétionnaire de l'administration en droit administratif. Découvrez cette copie de droit administratif sur la thématique du contrôle juridictionnel de l'exercice du pouvoir discrétionnaire de l'administration (note : 14/20). 🔥. N.B.: Cette copie est le fruit de la réflexion d'un étudiant ...
Le corps enseignant vous demande d'introduire vos copies de dissertation et de commentaire de texte par une citation d'accroche. > Un ouvrage pratique et facile à utiliser. Plus de 800 citations sont classées en 61 thématiques qui correspondent à la totalité des grandes notions développées en cours de droit administratif.